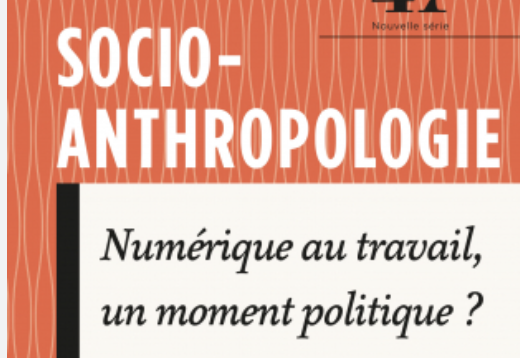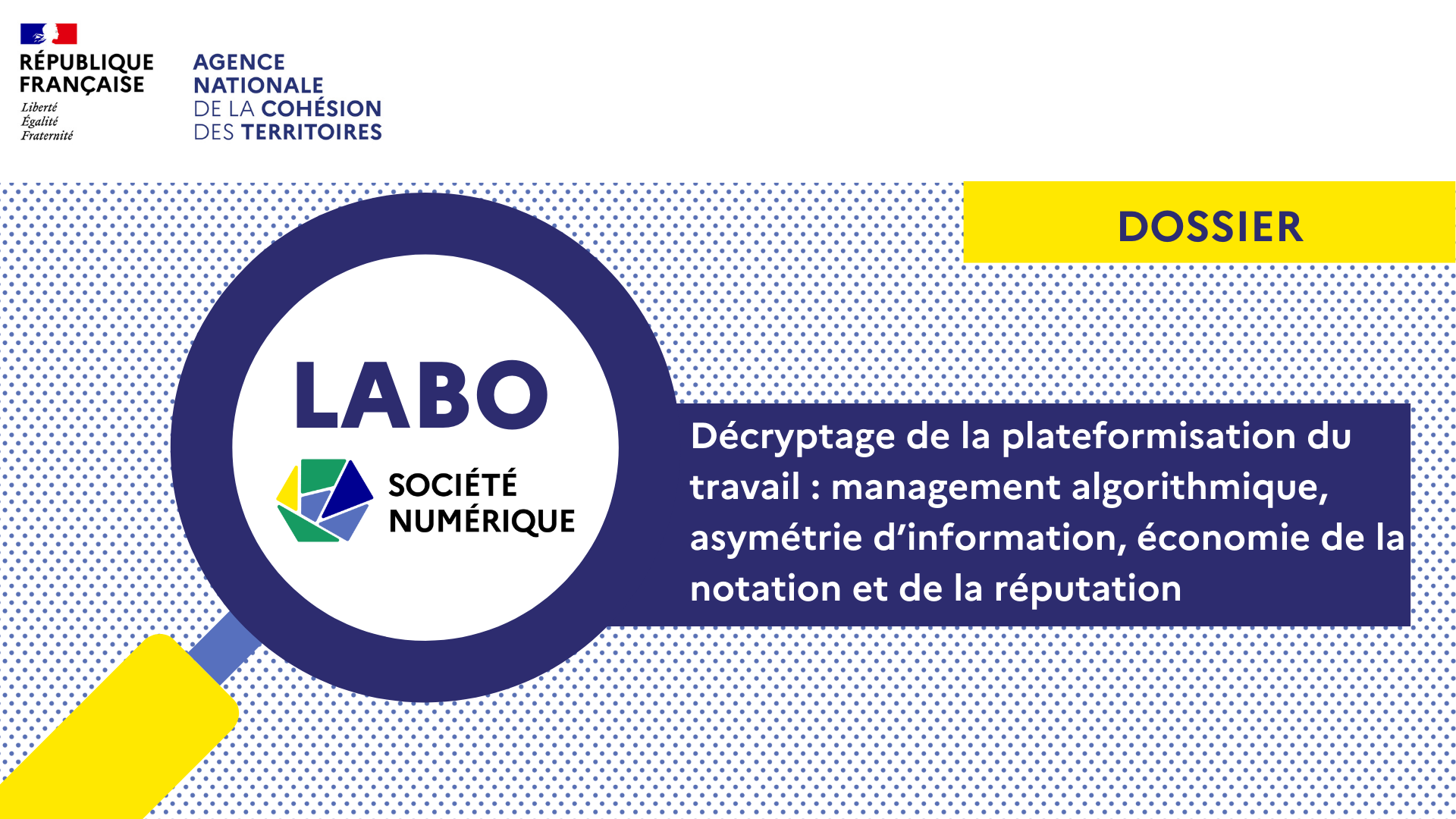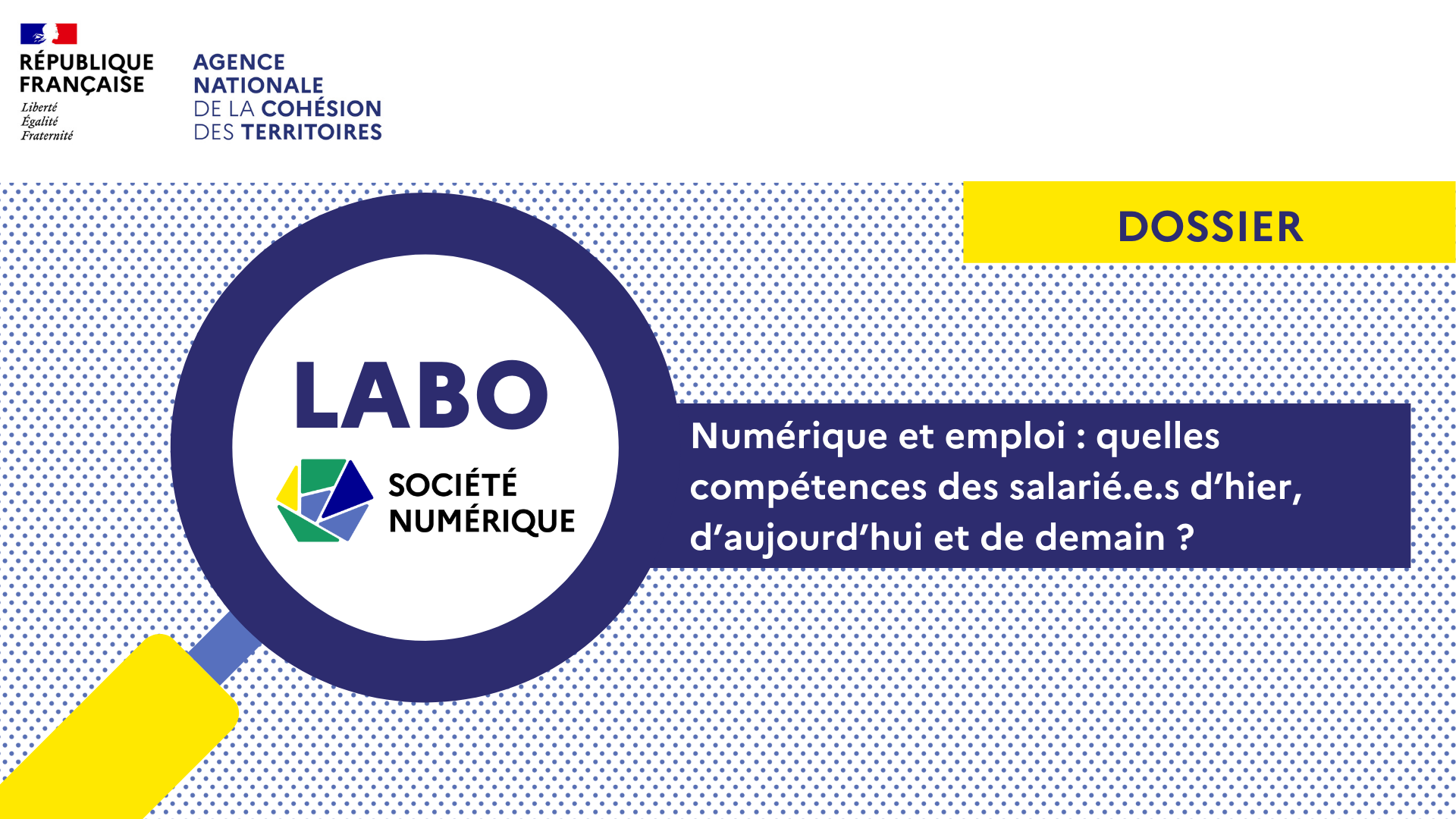« L’omniprésence des systèmes d’information comme leurs caractéristiques spécifiques influencent en profondeur et sur le long terme le fonctionnement des organisations et la vie de leurs membres. Refontes unilatérales des processus, attributions (non débattues) au système d’information de décisions auparavant prises par des personnes, omniprésence et pouvoir (démesuré) des indicateurs : tous les secteurs et toutes les fonctions des organisations sont aujourd’hui concernés. »
- Numérique au travail, un moment politique ?
La revue Socio-anthropologie consacre un dossier aux systèmes d'information numériques (SIN) dans le monde du travail.
Référence :
Appuyé sur une grande diversité de terrains d’enquête ou d’expérimentation (organisations théâtrales, plateformes de mobilité, archéologie, archives publiques, transport de marchandises, services de santé, université..) ce dossier décrit un paysage nuancé de l’influence des systèmes d'information sur le travail : risque de délitement des collectifs, travail « empêché », recherche de l’acceptabilité sociale du système d’information plus que de sa pertinence, mais aussi utilisations inventives de ce systèmes (non prévues par ses concepteurs), résistances professionnelles conduisant à l’évolution du système…
Dans un texte introductif, après un passage en revue de la riche littérature consacrée au numérique au travail, Maryse Salles, maître de conférences en informatique à l'Université de Toulouse et Raphaëlle Bour, Docteure en informatique, coordinatrices de ce dossier, dégagent six thématiques.
- La première est celle des rapports entre systèmes d’information numériques et démocratie dans les organisations : « La question est de savoir si (et comment) des sujets collectifs pourraient s’emparer des systèmes d’information dans une organisation » et « modifier concrètement les situations en y affirmant leur égale capacité ».
- La deuxième thématique est celle des mutations du travail des individus et des collectifs (contenu des tâches, normes de travail, structure des processus, processus de décision, critères de réussite, critères de qualité, interactions…) « et la façon dont elles sont vécues individuellement et collectivement, dont la souffrance au travail, mais aussi le sentiment de dépossession, la perte d’estime de soi que l’on retrouve dans les « bullshit jobs » analysés par David Graeber ».
- Une troisième thématique concerne les modifications dans les espaces d’autonomie des individus et des collectifs (périmètres de l’autonomie, néotaylorisme vs travail cognitif). « Cette autonomie est-elle liée à une plus grande responsabilité (sans que les moyens de celles-ci ne soient toujours donnés) ? »
- La quatrième thématique a trait aux réactions des membres de l’organisation face aux contraintes que les systèmes d’information font peser sur eux.
- Une cinquième thématique est celle des modifications des rapports de force au sein de l’organisation, et aussi avec son environnement immédiat (clients, financiers, fournisseurs…).
- La dernière thématique a pour objet la construction et l’évolution des systèmes d'information. Ici, l’interrogation porte sur les nouvelles méthodes de management des projets informatiques, notamment les « méthodes agiles », réputées plus « démocratiques », la place des intervenants externes à l’organisation (assistance à la maîtrise d’ouvrage, fournisseurs de logiciels standards…) et plus largement celle des experts (les « sachants informatiques »).
Mathilde Abel, étudiant(e) à Sciences Po Aix en Provence et Patrick Dieuaide, maître de conférences en économie (Université Sorbonne Nouvelle) analysent le rôle du travail digital dans la relation de dépendance des chauffeurs VTC à l’égard de la plateforme qu’ils utilisent. En permettant la mise en relation des chauffeurs avec un client, la plateforme est à la source d’un pouvoir de marchandage qui oblige les chauffeurs à une disponibilité permanente pour obtenir des commandes. « Il en résulte une forme particulière de subordination à la plateforme, qui altère fortement leur statut de travailleurs indépendants, et qui réduit à peu de chose l’autonomie réelle dont ils bénéficient, alors même que cette dernière est souvent à la base de leur engagement ».
Christophe Tufféry, ingénieur d'étude au Ministère de la Culture, étudie les effets des dispositifs numériques sur les pratiques et les identités professionnelles d’une profession : celle des archéologues. Se basant sur une centaine d’entretiens, l’auteur met en évidence le fait qu’en dépit de la force de la « machinerie numérique », « la dimension émotionnelle des savoirs archéologiques, comme la dimension sensible de l’expérience de terrain, sur les plans individuels et collectifs, demeurent très significatives (…) Une autonomie certaine des professionnels de l’archéologie subsiste donc dans une grande diversité de leurs pratiques scientifiques ».
En restituant le cas d’une salle d’exploitation d’un opérateur de transport de marchandises, Christophe Munduteguy, chargé de Recherche (Université Gustave Eiffel) restitue le « travail invisible » : « quand l’activité se fait hors du système d’information ». Dans cette activité, le transport de marchandises, faite d’imprévus et d’incertitudes, et l’outil numérique ne permettant pas toujours de gérer de manière efficace, « une large part du travail est ainsi réalisée hors du système voire « à son insu ».
Des archéologues qui s’approprient l’outil numérique de façon très diverse aux agents de la salle informatique du transporteur de marchandises, qui développent des ressources et des habiletés extérieures pour pallier les dysfonctionnements du système d’information, « il semble qu’une certaine ambivalence ou ambiguïté de l’outil numérique existe quant à son impact sur les collectifs de travail ».
C’est cette ambivalence de l’outil numérique que montre Marie Benedetto-Meyer, à l’issue d’entretiens auprès de 25 cadres utilisant Microsoft Teams. Marie Benedetto-Meyer, Maîtresse de conférences en sociologie (Université de technologie de Troyes) montre que Teams, loin de participer à l’émergence d’innovations organisationnelles et de management, renforce le risque de délitement des collectifs, d’éparpillement dans l’activité et de formes organisationnelles éclatées. L’enquête suggère néanmoins que « les cadres interrogés développent paradoxalement d’autres formes d’appropriations et utilisent l’outil afin de mieux gérer leur multi-activité et leur engagement dans des collectifs nombreux formels ou informels, le plus généralement peu structurés ex-ante ».
En rendant compte de l’introduction de chatbots dans une grande entreprise, Marion Gras-Gentiletti, docteure en ergonomie, met en relief la difficulté des dispositifs techniques dits « intelligents » à aider les salarié.e.s. Après avoir restitué le contexte qui pousse les industriels à innover à tout prix, l’autrice expose la façon dont « les salariés parviennent cependant à s’approprier ces dispositifs d’une manière différente de celle prévue par les dirigeants et les concepteurs de ces dispositifs ».
Si les outils numériques peuvent ainsi faire l’objet d’une appropriation par ceux qui les utilisent, qu’en est-il de l’évolution des relations entre les systèmes d’acteurs au sein des organisations comme entre l’organisation et son environnement ?
Le cas des systèmes d’information labellisés « maisons et centres de santé », étudiés par Manon Plégat, doctorante (Université de technologie de Troyes), illustre les négociations ou « l’équilibre négocié » qui se nouent autour des usages évolutifs des systèmes d’information. Ces systèmes d’information sont généralement présentés comme des supports techniques pertinents pour l’amélioration de la qualité et de la continuité des soins. Leur intégration aux pratiques des soignants révèle toutefois des défaillances techniques, qui nourrissent, à leur tour, des résistances professionnelles. En dépit des défaillances techniques et des résistances professionnelles, l’autrice estime que « les ajustements organisationnels, permis par les autorités de tutelle, et les redéfinitions successives des visées de ces systèmes, effectuées par les professionnels, permettent finalement la rencontre entre concepteurs-prescripteurs, usagers et dispositifs ».
Si le processus d’introduction d’un logiciel métier dans le monde professionnel des archivistes témoigne d’une culture organisationnelle peu participative, si la dimension technologique de l’outil, par les compétences qu’elle requiert, « accentue l’exclusion des agents des sphères de définition des procédés de travail », Maëlle Moalic-Minnaert, docteure en Science politique, observe moins une « transformation des rapports de force » qu’une « reconfiguration formelle du rôle occupé par chacun dans la définition des dispositifs de travail ». La vraie limite, conclut-elle, résulterait plutôt de « l’entrée en scène d’un prestataire extérieur imposant un cadrage cognitif mettant les services d’archives à distance du processus de décision ».
Des maisons de santé aux archivistes, lors du déploiement des outils numériques, les acteurs semblent ainsi parvenir, à trouver des arrangements ou de nouveaux équilibres et à faire évoluer la définition des dispositifs de travail.
Dans leur étude de cas consacrée aux cadres administratifs et techniques des organisations théâtrales, Chloé Langeard, Directrice du service UA-CULTURE chez de l'Université d'Angers et Marine Cordier, maîtresse de conférences en sociologie 'Université Paris Ouest Nanterre) montrent que les outils numériques (dont les progiciels de gestion), principalement destinés à la planification des ressources et à la maîtrise les coûts, « tiennent une place centrale dans l’activité des directeurs techniques et des administrateurs ». En leur permettant de contrôler la chaîne de production et de conforter leur légitimité professionnelle, « ces dispositifs participent à la reconfiguration des formes d’encadrement comme des rapports de force et de pouvoir entre cadres « métier » disposant d’une expertise technique et cadres « gestionnaires ».
L’association des usagers à la conception des services publics numériques constitue un leitmotiv des politiques publiques de numérisation. Les enquêtes réalisées au sein d’organismes d’intérêt général en Belgique révèlent l’ambivalence des dispositifs participatifs par rapport à la reconnaissance des besoins des usagers minorisés. « Leur implication vise non pas à interroger la pertinence et l’utilité du futur service leur étant destiné, mais à améliorer l’efficacité de ses modes opératoires ». Périne Brotcorne, chercheuse (Université catholique de Louvain), montre en filigrane que ces dispositifs participatifs « contribuent surtout à favoriser l’acceptabilité sociale de services numériques auprès de publics qui en sont éloignés, dans une logique de gouvernement des conduites ».
Maryse Salles, maîtresse de conférences en informatique (Université de Toulouse) et ses co-auteurs ont mis au point une méthode structurée, baptisée ISIDOR qui vise à permettre l’analyse et la mesure de l’impact d’un système d’information sur le niveau de démocratie d’une organisation. Ils reviennent ici sur une expérimentation de la méthode, conduite au sein d’une faculté d’une grande université, sur la base de deux dimensions de la démocratie : l’autonomie des utilisateurs et la réalité effective de ce qui est désigné dans la méthode comme étant la « dispute démocratique ». Les auteurs montrent que le SIN utilisé, bien approprié par les gestionnaires administratifs, dégrade en revanche le niveau d’autonomie des enseignants-chercheurs.
Dans l’entretien qu’elle a accordé à la revue, Danièle Linhart, directrice émérite de recherche au CNRS, sociologue reconnue pour ses travaux sur le travail, estime « qu’il n’y a aucune inéluctabilité dans le rôle que joue le numérique ».
Selon elle, il faut toujours repositionner le numérique dans la pensée managériale qui le porte et dans l’organisation du travail qui le met en œuvre. « Les logiciels, la démarche et la pratique numériques consistent à rendre abstraits les connaissances, l’expérience, les savoirs en les enracinant dans des programmes qui reposent sur des approches quantitatives, mathématiciennes, procédurales, accélérant ainsi pour les salariés un processus de dépossession de leurs savoirs. Le numérique apparaît dans cette perspective comme une sorte d’hyper-taylorisme ou une forme d’aboutissement rêvé du taylorisme ». Si on veut imaginer une démocratisation de l’usage du numérique dans les entreprises, il faudrait d’abord, selon Danièle Linhart, « penser une démocratisation de l’organisation du travail. Le numérique pourrait ainsi être un instrument extrêmement précieux de mise en débat, d’organisation de forums, de discussions, d’émulation, dans le cadre d’une refondation du travail et de l’entreprise ».
Sommaire
- Maryse Salles et Raphaëlle Bour : Ce que les systèmes d'information numériques font au travail
- Mathilde Abel et Patrick Dieuaide : Dualité des espaces de travail et nouvelle forme de subordination : Le cas des plateformes de mobilité
- Christophe Tufféry : Entre le carnet et la tablette. Contribution à l’étude des effets des dispositifs numériques sur les pratiques et les identités professionnelles des archéologues sur le terrain depuis les années 1970
- Christophe Mundutéguy : Le travail invisible ou quand l’activité se fait hors du système d'information numérique. Le cas de la salle d’exploitation d’un opérateur de transport de marchandises
- Marie Benedetto-Meyer : Les outils de travail collaboratifs, révélateurs et amplificateurs des tensions dans le travail des cadres
- Marion Gras Gentiletti « Je ne comprends pas votre question ». Le cas de l’introduction de chatbots dans une grande entreprise
- Manon Plégat : Les systèmes d’information partagés en maisons de santé. Entre contraintes techniques, ajustements organisationnels et enjeux professionnels
- Maëlle Moalic-Minnaert Les archivistes à l’épreuve du « logiciel métier ». Une participation reconfigurée
- Chloé Langeard et Marine Cordier : (En)jeux autour des outils de gestion numériques. Le cas du travail des cadres administratifs et techniques des organisations théâtrales
- Périne Brotcorne : Numérisation des services d’intérêt général et représentation des usagers minorisés. Une participation sans pouvoir ?
- Maryse Salles, Raphaëlle Bour, Gabriel Colletis, Lycette Corbion-Condé, Étienne Fieux et Anne Isla : Évaluer l’impact d’un système numérique sur le niveau de démocratie d’une organisation. Proposition de méthode
- Entretien avec Danièle Linhart. Le numérique, aboutissement rêvé du taylorisme ?