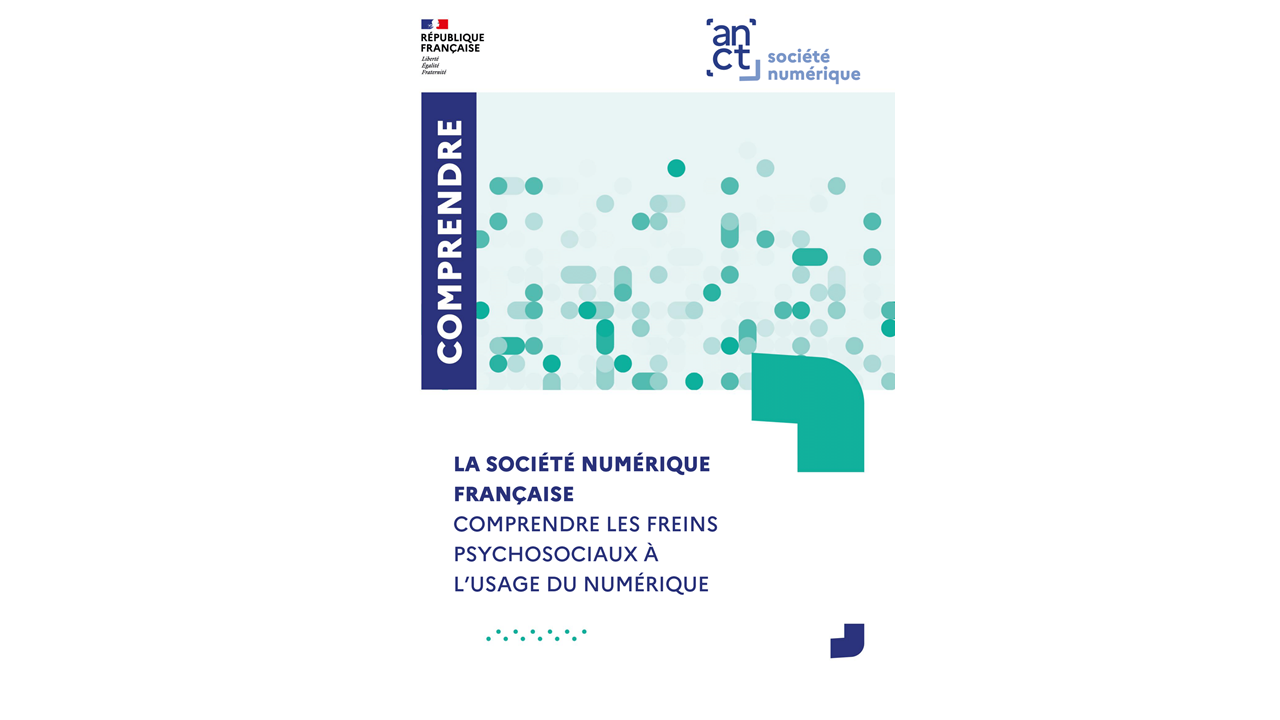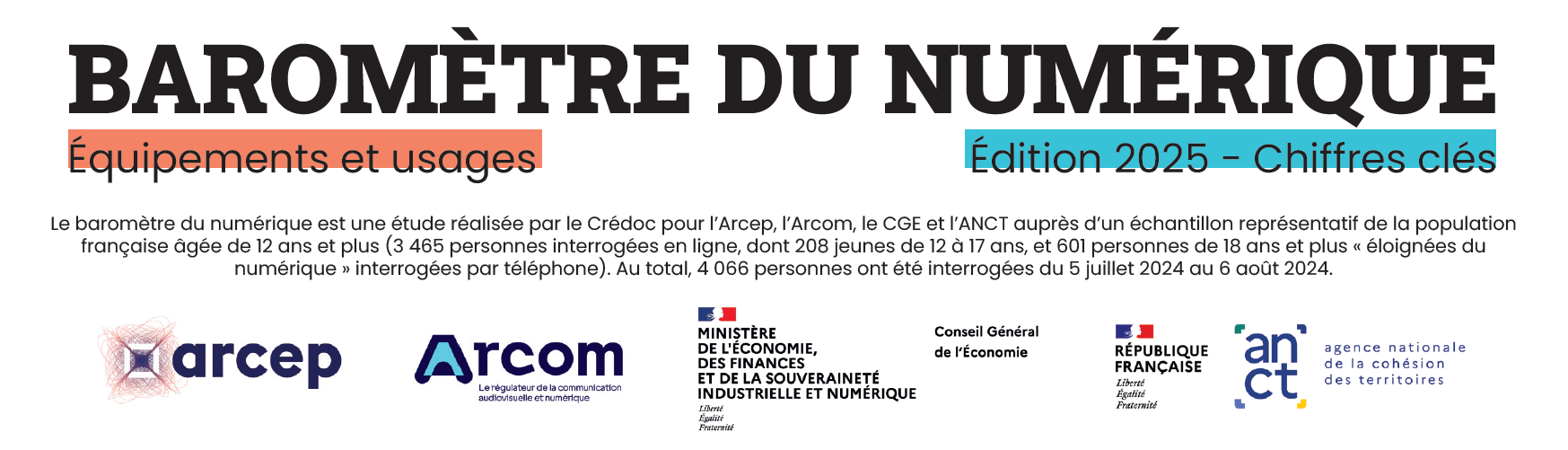Avant-propos
En 2021, le Programme Société Numérique de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), a lancé une consultation pour la production d’une série d’études sur l’état de l’art de la société numérique française. C’est dans ce cadre que le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) et le Centre de recherche sur l’éducation, les apprentissages et la didactique (CREAD), associé au GIS M@rsouin, mènent un travail de diagnostic et d’analyse qui donne lieu à une série de rapports thématiques. La première édition, publiée en avril 2023, portait sur la définition et la mesure du phénomène d’éloignement numérique. La deuxième, publiée en mars 2025, a mis en lumière les actions des professionnels du secteur de la médiation numérique en montrant à quel point celles-ci couvrent tous les champs de la vie quotidienne des individus et doivent, en conséquence, être pensées en complémentarité avec les actions des autres professionnels du secteur social, socioculturel et administratif. La troisième et dernière édition de cette série d’études vise à fournir des clefs de compréhension de la présence de freins psychosociaux à l’usage du numérique dans la population tout en suggérant des pistes de réflexions pour les réduire loin de toute forme d'injonction. En mobilisant de manière inédite la littérature scientifique et les études quantitatives les plus récentes sur le sujet, cette étude nous plonge dans les dynamiques sociales et culturelles qui sous-tendent l’appropriation des technologies numériques. Le présent article délivre une synthèse de cette dernière étude.
Pour citer l'étude :
ANCT, CREDOC, Université Rennes 2 CREAD-M@rsouin, La société numérique française : comprendre les freins psychosociaux à l'usage du numérique, 2025.
Les documents de l'étude
Document PDF
Document PDF
Les freins psychosociaux, facteurs d’inégalités socionumériques
En dépit de la diffusion massive des équipements numériques et de la démocratisation de l’accès à Internet dans la population française depuis une vingtaine d’années, la grande hétérogénéité des usages interroge. Pourquoi, toutes choses égales par ailleurs, certaines personnes s’approprient-elles certaines technologies et développent certains types d’usages, là où d’autres les ignorent ou les refusent ? La part de personnes non connectées ou distantes des technologies numériques est ainsi bien plus importante parmi les milieux modestes peu diplômés, par rapport aux milieux plus favorisés et plus diplômés. Or, la massification de l’accès à Internet ne permet plus d’invoquer des raisons purement économiques (même si celles-ci peuvent continuer à jouer un rôle dans certains foyers).
Dans ce contexte, et dans la lignée de l’ambition formulée lors des travaux de concertation dans le cadre du Conseil National de la Refondation Numérique (CNR), il apparait crucial d’appréhender la nature des « freins psychosociaux » à l’appropriation des technologies numériques. Le terme « psychosocial » fait référence aux effets des processus sociaux et cognitifs sur la manière dont les individus perçoivent, influencent et interagissent. L’idée de « freins psychosociaux » (psychosocial barriers) concerne plus particulièrement les croyances, valeurs, attitudes ou perceptions individuelles qui entravent la participation à des activités d'apprentissage.
Pour répondre à cet enjeu, l’étude intitulée « La société numérique française : comprendre les freins psychosociaux à l’usage du numérique » fournit des clefs de compréhension des différentes formes de distances vis-à-vis des technologies numériques, permettant d’entrevoir des pistes de réduction des freins psychosociaux à l’usage du numérique. Après avoir dressé un panorama de ces freins, cette étude explore, en s’appuyant sur la littérature scientifique et des études quantitatives, les conditions d’appropriation des technologies et de constructions des usages par les individus et les groupes d’individus, en mettant en avant le rôle joué par les contextes sociaux et de vie. Elle propose également une typologie des postures entretenues par les Français et Françaises vis-à-vis des technologies numériques.
Panorama des freins psychosociaux à l’usage du numérique
Pour dresser un panorama des freins psychosociaux à l’usage du numérique, il convient de considérer que ces derniers relèvent moins de difficultés strictement techniques ou matérielles que de la manière dont les individus évaluent les risques ou se sentent légitimes à investir les environnements numériques. En ce sens, ils constituent une dimension transversale pouvant venir limiter l’inclusion numérique des populations. De nombreux freins sont susceptibles de revêtir un caractère psychosocial, car même des obstacles tangibles (un coût, un risque, une contrainte) sont vécus et intériorisés dans des contextes sociaux et symboliques qui en amplifient ou en atténuent la portée.
Le passage en revue des freins déclarés par la population révèle cette dimension psychosociale venant nourrir les trois grandes familles de freins observables : protection, socioculturels et adhésion. Les freins de protection concernent 47 % de la population et se centrent sur l’identification de risques tangibles comme la cybercriminalité, les vols de données ou le harcèlement en ligne. Ils se fondent sur des croyances qui dépassent le fait d’avoir été ou non réellement victime de préjudice et peuvent contribuer à nourrir des stratégies d’évitement ou de limitation des usages numériques (achats, partage de contenu personnel). Les freins socioculturels sont présents auprès 40 % de la population et reposent directement sur une posture psychosociale : celle de ne pas suffisamment maîtriser les outils, de commettre des erreurs ou de se sentir financièrement exclu. Cette représentation de ses propres compétences numériques mais aussi de son niveau d’équipement reflète autant des expériences personnelles d’échec que la perception d’un décalage social et financier, notamment par rapport à un niveau de compétences ou d’équipement perçu comme nécessaire pour des usages numériques « standard » (répondant à la norme dominante). Enfin, les freins à l’adhésion du numérique sont présents parmi 20 % de la population et se traduisent par une prise de distance volontaire ou par désintérêt à l’égard du numérique, s’ancrant ainsi pleinement dans une dimension psychosociale puisqu’ils reflètent des valeurs, préférences ou postures.
À l'origine des freins psychosociaux, les dynamiques d’appropriation
L’origine du caractère psychosocial des freins observés à l’usage du numérique ne peut être comprise qu’en replaçant ces usages dans des dynamiques d’appropriation. La notion d’appropriation aide en effet à comprendre le rôle actif des usagers dans la construction sociale des technologies et des usages : pour qu’un dispositif soit utilisé et socialisé, il doit pouvoir s’insérer dans un contexte social et culturel donné, en laissant à l’usager la possibilité de l’intégrer à sa vie quotidienne tout en l’adaptant de manière plus ou moins créative à ses propres besoins et projets.
Or, il existe, dans tout dispositif sociotechnique, un « usage prescrit » qui renvoie à ce qui est attendu de la part des futurs usagers par ses concepteurs. En effet, les concepteurs de ces dispositifs ont leurs propres représentations des goûts et attentes des usagers potentiels, influencés par leur propre positionnement social et culturel. Dans les faits, les concepteurs inscrivent bien souvent, dans le design des dispositifs, une vision idéalisée et stéréotypée de l'utilisateur « moyen », à l’aise à l’écrit, capable de naviguer dans des interfaces complexes. De son côté, l’usager réel adopte rarement une attitude passive face aux prescriptions. Tout dispositif est en réalité approprié (ou non-approprié) par les usagers qui développent des « arts de faire » qui leur sont propres. Dans les faits, l’usage est à la fois influencé par l’outil tel qu’il a été conçu (le design de l’interface et ses choix techniques) et par des pratiques et représentations sociales préexistantes.
Les contextes sociaux et de vie des différentes catégories de la population influencent directement leur rapport au numérique. Ils sont notamment orientés par la présence de normes sociales présentes dans leurs groupes d’appartenance. Il en résulte une appropriation socialement différenciée des dispositifs sociotechniques, le rapport à l’écrit est un bon exemple : le courriel étant largement approprié par les cadres là ils où est peu utilisé par les milieux modestes peu diplômés. Certaines normes d’usages sont toutefois davantage valorisées socialement que d’autres, voire imposées dans certaines circonstances, comme c’est le cas pour l’usage du courriel exigé dans les correspondances administratives.
Une distance vis-à-vis des normes d’usages peut alimenter un phénomène de « mépris de soi » pour les personnes qui la subisse. Le manque d'intérêt ou le rejet affiché du numérique apparaissent dès lors comme une raison socialement légitime de ne pas utiliser Internet.
En outre, pour certains métiers où l’usage des technologies numériques est omniprésent, comme c’est le cas pour certains cadres, des formes de mise à distance volontaires existent parfois, visant à « reprendre le contrôle » des usages. Celles-ci prennent la forme de déconnexion volontaire, souvent partielles, par exemple en dehors des horaires de travail.
Typologie des postures psychosociales à l’égard du numérique
Ces logiques d’appropriation différenciée s’incarnent dans une typologie de quatre grandes postures psychosociales à l’égard du numérique. Les Réfractaires (7 % de la population) entretiennent une distance assumée au numérique, cohérente avec leurs valeurs et modes de vie, sans réelle frustration. À l’opposé, les Technophiles (37 %) expriment une confiance marquée, estimant que le numérique facilite leur quotidien ; ils sont socialement proches des concepteurs (diplômés). Entre ces deux pôles, deux groupes traduisent les tensions propres aux freins psychosociaux : les Empêchés (18 %), freinés par un sentiment de manque de compétences, de légitimité ou d’équipements adéquats et pourtant adeptes de pratiques numériques et considérant généralement le numérique sous un angle positif ; et les Inquiets (37 %), dont les usages sont traversés par la crainte de perdre le contrôle, en particulier autour des données personnelles et des nouvelles technologies et ont un regard plus nuancé du numérique, surtout utilisé pour son caractère pratique (démarches en ligne, achats) plutôt que par goût, comme pour leurs loisirs. Ces postures, loin d’être anecdotiques, reflètent la manière dont les inégalités sociales et les normes d’usage viennent peser sur les parcours d’appropriation du numérique.
Une mise à distance des normes sociales d’usages dominantes
Dans un contexte de numérisation croissante des activités et démarches de la vie quotidienne dans une société, l’étude « La société numérique française : comprendre les freins psychosociaux à l’usage du numérique » met en lumière le rôle central joué par les contextes sociaux et de vie dans les rapports variés entretenus par les individus vis-à-vis du numérique. Dès lors, la distance vis-à-vis des technologies peut être, dans certains cas, appréhendée comme une distance vis-à-vis des normes sociales d’usages dominantes. Ces normes dominantes peuvent être influencés par la configuration des dispositifs sociotechniques, le design et les propriétés techniques des dispositifs. Ces derniers étant toujours le résultat de choix émanant des acteurs de la conception, en tant que porteurs de valeurs et d’intérêts particuliers. De la même manière, ces normes sociales d’usages dominantes tendent à refléter les usages des milieux les plus à l’aise avec les technologies, souvent les plus aisés et diplômés, qui constituent dès lors la norme de l’ « usager standard », invisibilisant les autres groupes sociaux. Or, les technologies numériques ne peuvent être réellement appropriées que si elles peuvent s’insérer dans la vie quotidienne des usagers. A cet égard, la typologie psychosociale d’usagers du numérique réalisée dans le cadre de ce rapport montre qu’une majorité de la population se trouve, à des degrés divers, en décalage avec les normes sociales d’usages.
La prise en compte de la diversité des mondes sociaux comme levier de déploiement d’un numérique capacitant
Par conséquent, cette même étude encourage une réflexion sur la prise en compte de l’hétérogénéité des « mondes sociaux » des individus et groupes d’individus dans la définition des politiques publiques d’inclusion numérique et le déploiement des activités de médiation numérique. Une meilleure considération de la diversité des usagers apparaît constituer une condition sine qua non au développement d’un numérique capacitant pour le plus grand nombre, en mesure de s’inscrire dans le quotidien des citoyens qui le souhaitent.
A ce titre, s’il semble légitime dans de nombreux contextes de mesurer le niveau d’appropriation des technologies numériques de la population, l’évaluation de « compétences numériques de base » ne sauraient rendre compte de cette hétérogénéité des « mondes sociaux » des usagers du numérique. En effet, cette approche laisse de côté le rapport psychosocial au numérique, c’est-à-dire l’ensemble des croyances, perceptions et postures qui sous-tendent le processus d’appropriation des technologies numériques des individus. En réalité, en se limitant à une sélection de compétences liées à des grilles d’usages numériques, elle appréhende surtout la proximité à des normes sociales d’usages dominantes (comme le courriel) et moins la capacité à se saisir des outils numériques dans sa vie quotidienne selon ses besoins. Pour appréhender cette capacité à se saisir du numérique au-delà des seuls gestes techniques et standardisés, une approche alternative consisterait à interroger le rapport subjectif des individus au numérique qui est un élément déterminant pour le développement d’usages numériques capacitants.
Enfin, si toute injonction à utiliser le numérique apparaît dès lors comme incompatible avec la réduction des freins psychosociaux à l’usage du numérique, l’atteinte de cette ambition consisterait principalement à faire reculer le déploiement d’un numérique standardisé qui produit des normes sociales d’usages excluantes, tout en proposant une médiation numérique capacitante adaptée aux « mondes » sociaux et culturels des citoyens.