Depuis quelques années, les projets de "territoires intelligents" se multiplient. Des appels à projets nationaux incitent les collectivités à organiser la collecte et l’utilisation massive des données au service des politiques publiques, y compris en ayant recours à l’intelligence artificielle. Alors que les risques cyber sont plus forts que jamais, la question de la souveraineté numérique préoccupe de plus en plus les collectivités : choix des éditeurs de logiciels, hébergement des données en Europe ou en France, maîtrise des données par la collectivité…
Deux ans après sa création, l’Observatoire Data Publica, vient de publier, en partenariat avec l’Institut Ipsos, une enquête menée auprès de plus de 300 élu.e.s, cadres numériques (SI, SIG, data) ou autres DPO (délégués à la protection des données) représentant 277 collectivités, qui vont de la grande à la petite commune, en passant par la région, le département, la métropole, l’EPCI ou le centre de gestion.
Avec ses partenaires (la Banque des Territoires, l’ANCT, le Groupe La Poste, La Gazette), l’Observatoire Data Publica a souhaité comprendre et mesurer la manière dont les collectivités appréhendent les multiples enjeux liés à la gestion des données :
- La définition de priorités et de stratégies ;
- La prise en compte d’enjeux juridiques ou éthiques ;
- Les choix technologiques et notamment la cybersécurité ou encore le recours à l’IA ;
- La gouvernance, l’organisation de la gestion et le management de la donnée ;
- La transparence et la démocratie ;
- La sobriété numérique.
Référence :
Les collectivités locales et le règlement européen, un effet de taille important
72% des collectivités locales au moins partiellement en conformité avec le règlement européen.
26% des collectivités estiment être en conformité avec le RGPD (règlement général sur la protection des données), et 46% en voie de l’être.
L’effet taille est important :
- 89% des métropoles, 100% des régions ou encore 100% des communes de plus de 100 000 habitants s’estiment déjà en conformité ou en voie de l’être.
- 19% des communes de moins de 3 500 habitants estiment ne pas être encore engagées dans une démarche de mise en conformité. Seuls 61% s’estiment en conformité ou en voie de l’être.
- Seuls 26% des départements s’estiment en conformité avec le RGPD (et 52% en voie de l’être).
86% des collectivités ayant répondu à l’enquête déclarent avoir nommé un DPO dont 53% en interne, 13% de façon mutualisée avec d’autres collectivités et 20% en ayant recours à un prestataire.
100% des métropoles, des régions et des communes de plus de 100 000 habitants ont désigné un DPO, ainsi que 96% des départements. Ces chiffres sont cohérents avec les données publiées par la CNIL.
En revanche, 30% des communes ayant répondu à l’enquête ayant moins de 3 500 habitants déclarent ne pas avoir désigné de DP. « Ce chiffre est probablement inférieur à la réalité dans l’ensemble de la strate puisque 66% des communes de moins de 3 500 habitants n’ont pas de DPO ».
Au-delà de la désignation d’un DPO, la mise en œuvre du RGPD est un processus qui nécessite une adaptation des règles de gestion des données au sein de la collectivité :
- 59% des collectivités déclarent avoir modifié ce processus. Ce pourcentage atteint 83% pour les métropoles et 80% pour les régions.
- 34% des communes (et 43% des communes de moins de 3 500 habitants) déclarent ne pas avoir changé leurs méthodes de gestion des données personnelles.
50% des collectivités interrogées ont mis en place des clauses juridiques sur la gestion des données
Ces clauses concernent prioritairement la mise en œuvre du RGPD dans 96% des cas.
Ces clauses concernent aussi la maîtrise publique des données (58 %), la publication des données en open data (44 %) ou encore le respect de standards imposés par la collectivité (34%).
« L’existence de clauses sur des formats et des standards de données, indicateur de forte maturité sur la data, concerne très majoritairement les régions (44 %) et surtout les grands EPCI (46 %) et les métropoles (56%). Le sujet et ses implications juridiques sont le plus souvent identifiés par des territoires engagés dans des projets de « territoire intelligent » et confrontés directement à des enjeux d’interopérabilité ».
De nouveaux usages des données orientés en premier lieu vers la gestion administrative
« L’utilisation des données offre aux collectivités la possibilité d’améliorer l’efficacité de certaines politiques publiques. Ces cas d’utilisation sont multiples (éclairage intelligent, ramassage connecté des déchets, régulation du trafic…). Elle offre aussi la possibilité d’améliorer la connaissance du territoire, d’évaluer les politiques publiques ou encore de créer de nouveaux services aux usagers ».
36% des collectivités déclarent avoir engagé ces deux dernières années une (ou des) expérimentation(s) autour des données
Le facteur taille est déterminant. Ont réalisé des expériences, tests, POC ou prototypes au cours des deux dernières années : 90% des régions, 89% des métropoles, 57% des communes de plus de 100 000 habitants et 56% des départements.
- Le gestion administrative (dématérialisation des processus de gestion) figure en tête des nouveaux usages de la donnée : mentionné par 65% des collectivités, cet usage concerne toutes les strates de collectivités, y compris les plus petites.
- 60% des collectivités attendent des innovations grâce aux données pour la mobilité.
- Viennent ensuite l’aménagement du territoire (59%), la gestion de l’environnement (58%), la gestion du patrimoine (49%), la citoyenneté (48%), la gestion des déchets (44%)
- « Quant au sujet de la sécurité, pour lequel l’usage de la donnée est parfois polémique et décrié, il ne retient l’attention que de 37% des collectivités ».
La priorité des collectivités qui veulent accroître leur utilisation des données n’est pas le retour immédiat sur investissement
- Seules 8% des collectivités attendent en priorité un retour immédiat sur investissement (ROI) et ceci vaut quelle que soit la taille de la collectivité.
- 49% des collectivités attendent du recours plus important aux données un impact sur la relation aux usagers. Ce « retour sur les usages » est la première priorité pour les départements (59%) et les communes (57%).
- 44% des collectivités classent en première priorité les retombées sur l’efficacité des politiques publiques (ROP). C’est très majoritairement le cas des régions (70%) et des EPCI (61% pour les métropoles et 58% pour les EPCI hors métropoles).
La gouvernance des données, première étape vers une stratégie de la donnée
« L’utilisation de plus en plus massive des données implique souvent de mettre en place une gouvernance de la donnée, c’est-à-dire un ensemble de règles et de principes concernant la collecte, le stockage et le traitement des données. Par exemple, certaines collectivités imposent un hébergement local des données, définissent le format de certaines données, proposent des conventions avec des règles d'accès et de confidentialité... ».
L’introduction de règles de gouvernance de la donnée est une réalité dans 25 % des collectivités Et pour l’essentiel dans les plus grandes (et les plus expérimentées) 60% des régions, 57 % des communes de plus de 100 000 habitants, 44% des métropoles et 41% des départements.
« Ces chiffres montrent, commentent les concepteurs de l’Observatoire, qu’il y a une étape importante qui reste à franchir y compris dans les grandes collectivités, pour passer des premiers essais à la mise en place de véritables stratégies territoriales de la donnée. Cette étape est celle de la construction d’une gouvernance data ».
Seules 10% des collectivités ont associé des citoyens à la définition de règles de gouvernance de la donnée
Ces rares démarches de participation citoyenne sont aujourd’hui principalement le fruit de collectivités pionnières, en l’occurrence presque exclusivement des métropoles : 38% des métropoles déclarent associer les citoyens / la société civile à la définition de travaux sur la gouvernance des données.
Parmi elles figurent Nantes (panel citoyen pour l’élaboration de la charte métropolitaine de la donnée), Brest (organisation d’une conférence de consensus sur la donnée), Dijon (comité métropolitain de la donnée), Rennes (implication citoyenne dans le projet RUDI) ou encore Lyon , Lille ou La Rochelle (démarches de self data).
Seules 6 % des collectivités ont mis en place une charte éthique de la donnée
34% des collectivités, toutefois envisagent d’en adopter une, qu’elles élaboreront elles mêmes ou déclineront à partir d’un modèle existant.
Parmi ces dernières, les métropoles arrivent en tête (67% expriment le souhait d’adopter une telle charte) suivies par les régions (66%).
Un niveau d’acculturation des collectivités aux enjeux data jugé encore très insuffisant
65% des répondants estiment que les enjeux de la donnée ne sont pas identifiés ou insuffisamment compris dans la collectivité.
Seuls 7% estiment que le niveau d’acculturation aux enjeux data est bon.
Malgré l’expérience acquise et la maturité accumulée au fil des ans, les collectivités, y compris les grandes, estiment le niveau de culture de la donnée insuffisant (ou le sujet ignoré). C’est le cas dans 40% des régions, 45% des métropoles et 60% des autres EPCI. Le chiffre atteint 76% globalement dans les communes.
« Ces chiffres tendent à montrer que la question de la « culture data » reste très importante , y compris dans les grandes collectivités ayant le plus d’expérience. Ceci peut sans doute s’expliquer par le fait que les projets data restent très majoritairement pilotés par de petites équipes voire des experts isolés, sans que la culture data ne se diffuse encore suffisamment autour d’eux ».
Des outils de traitement et d’analyse de données en place ou en cours de déploiement dans 49% des collectivités
C’est le cas très massivement dans les métropoles (94%), les régions (90%), les villes de plus de 100 000 habitants (86%) les départements (81%). Seules les communes de moins de 3500 habitants sont très en retrait avec 10% de recours à ces outils.
Les sujets de la standardisation des données et de l’interopérabilité sont pris en compte par moins de 40% des collectivités interrogées parmi lesquelles figurent essentiellement les métropoles (respectivement 83% et 89% ) et les régions (respectivement 70% et 90%). Ceci s’explique à la fois par une plus forte maturité sur la donnée, la nature des compétences et les modes d’exploitation, et un besoin accru de proposer des systèmes qui puissent dialoguer avec des outils infra ou extra territoriaux.
La mise en place de capteurs et de réseaux IdO (Onternet des Objets) concerne 25% des collectivités interrogées. Ce chantier est fortement mis en avant par les métropoles : 85% d’entre elles en déploient, essentiellement dans leurs démarches de "territoire intelligent".
L’installation d’un lac de données est une solution peu identifiée. Elle concerne 13 % des collectivités parmi lesquelles on compte principalement les communes de plus de 100 000 habitants (58 %).
La souveraineté numérique s’invite sur l’agenda des collectivités
« La question de la souveraineté numérique est mise en avant de façon récurrente dans les débats nationaux ou européens. Elle est aussi présente au niveau local concernant le choix d’outils ou l’hébergement La question de la maîtrise publique des données reste, toutefois, un sujet mal identifié. »
Seules 23% des collectivités ont défini des orientations sur le sujet. Les grandes collectivités se distinguent : 60% des régions et 56% des métropoles affirment avoir défini une politique de souveraineté sur les données.
49% des collectivités privilégient, lorsque c’est possible, des logiciels français ou européens
« Cette tendance est comparable quelle que soit la strate administrative concernée ce qui tend à montrer que les préoccupations liées à la souveraineté numérique sont présentes à tous les niveaux ».
Le choix systématique de l’open source n’est fait que par 7% des collectivités. Il peut être ponctuel (dans 30% des cas mais dans 38% des cas, la collectivité n’en fait pas un critère de sélection Ce choix est toutefois retenu à 57% dans les communes de plus de 100 000 habitants et à 50% dans les régions et les métropoles.
62% des collectivités gèrent leurs données sur des serveurs internes
A l’opposé des discours ambiants sur le recours au cloud, une très grande majorité (62%) de collectivités privilégie l’hébergement sur des serveurs internes. C’est le cas pour 85% des départements 58% des communes, pour 67% des métropoles 56% des communes de moins de 3 500 habitants.
L’hébergement dans un « cloud » sécurisé (labellisé SecNum par l’État) est une option identifiée mais rarement privilégiée, sauf par 14% des communes et 7% des métropoles.
Seules les régions se distinguent : elles recourent à 40 % à un serveur interne et à 30% à des centres de données publics locaux.
L’hébergement des données à distance via le recours à des logiciels en Saas représente le 2ème mode d’hébergement le plus utilisé (13%).
89 % des collectivités s’estiment exposées à des risques cyber
« Comme toutes les organisations, les collectivités territoriales sont concernées par les enjeux de sécurité des systèmes d’information. Depuis 2 ou 3 ans, celles qui ont été la cible d’attaques spécifiques, pouvant totalement bloquer leurs services, rapportent des pertes financières, une perte de temps et une perte de confiance de leurs administrés ».
89% des collectivités s’estiment exposées à des risques cyber et 57% estiment que cette exposition est continue ou fréquente. Seules les petites communes relativisent ce risque : 26 % des communes de moins de 3 500 habitants estiment ne pas être exposées. A l’inverse 100% des régions, des départements, des métropoles et des communes de plus de 10 000 habitants ont pris conscience du danger.
Ces chiffres progressent très rapidement. Une étude réalisée pour le compte de la FNCCR en avril 2021 montrait que 56 % des collectivités de plus de 100 000 habitants s’estimaient fréquemment ciblées Elles sont 86% en 2022.
24 % des collectivités estiment que le niveau de prise en compte du risque est bon. Ce chiffre atteint 67% dans les métropoles et 50 %dans les régions. Le sujet n’est « pas identifié » dans 13% des collectivités.
De façon très claire, la taille de la commune influe sur la prise en compte du risque. En effet, le sujet n’est pas traité ou l’est de façon insuffisante dans 62% des communes de moins de 3 500 habitants, dans 35% de celles de 3 500 à 10 000 habitants, dans 33% de celles entre 10 000 et 100 000 habitants mais aussi dans 26% des départements, 20% des régions et 6% des métropoles.
Les obstacles à la prise en compte et à la diffusion des outils de cybersécurité sont multiples, manque de temps (47%), manque de compétences (46%), manque de budgets (44%), difficultés de recrutement (17%).
Les collectivités engagées dans une démarche de cybersécurité le font avec méthode et mobilisent l’arsenal des bonnes pratiques. Les pourcentages de mise en œuvre sont proportionnels à la taille des collectivités : 100 % des métropoles, 80% des régions ou 71% des communes de plus de 100 000 habitants ont désigné un responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) contre 13% des communes de moins de 3 500 habitants et 29% de celles de 3 500 à 10 000 habitants.
Des stratégies de numérique responsable en cours d’élaboration
A partir de 2025 les collectivités de plus de 50 000 habitants devront adopter une stratégie numérique responsable.
Pour 33% des collectivités, une stratégie numérique responsable est en cours d’élaboration ou a déjà été adoptée, et de manière très importante par les régions (80%) et les métropoles (72%). L’enquête a été administrée avant la parution du décret du 29 juillet 2022 précisant les obligations à venir pour l’élaboration d’une stratégie numérique responsable pour les communes et EPCI de plus de 50 000 habitants.
Articles en lien
-
Innovation
-
Innovation
-
Innovation
-
Donnée
De Lutèce à CitéLibre : la ville de Paris propose une suite de logiciels libres destinée aux collectivités
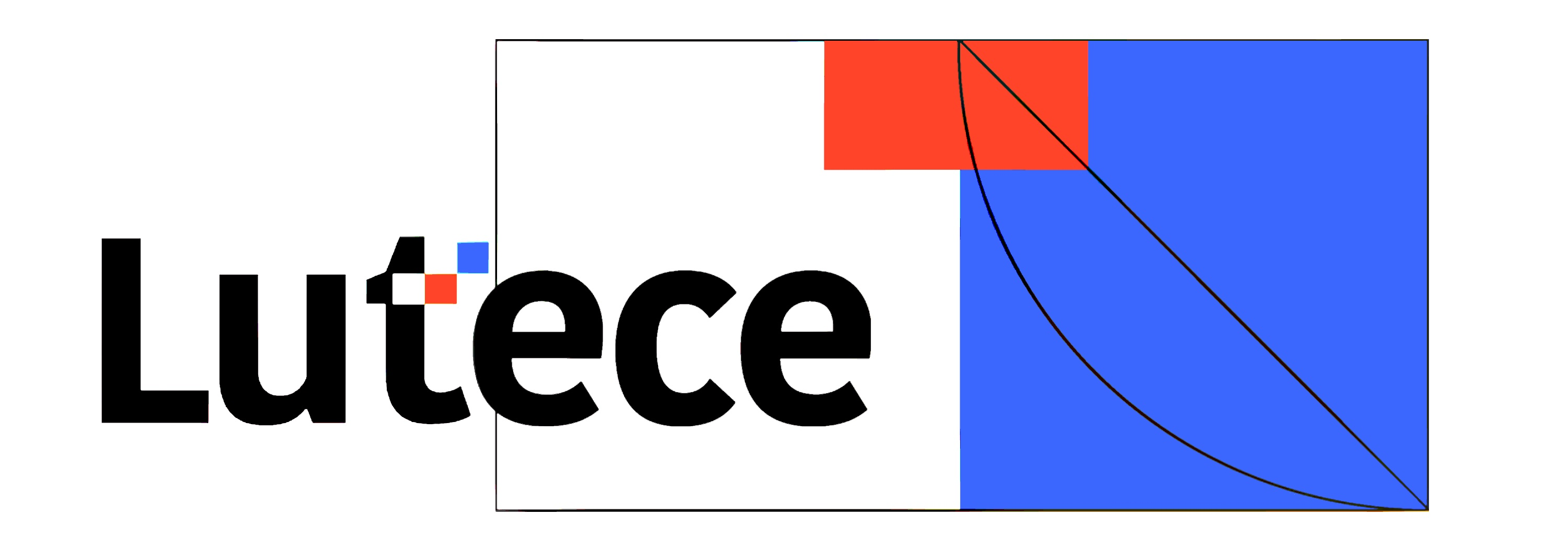
[Dossier] Les collectivités territoriales face aux enjeux de cybersécurité : quels leviers d'action ?
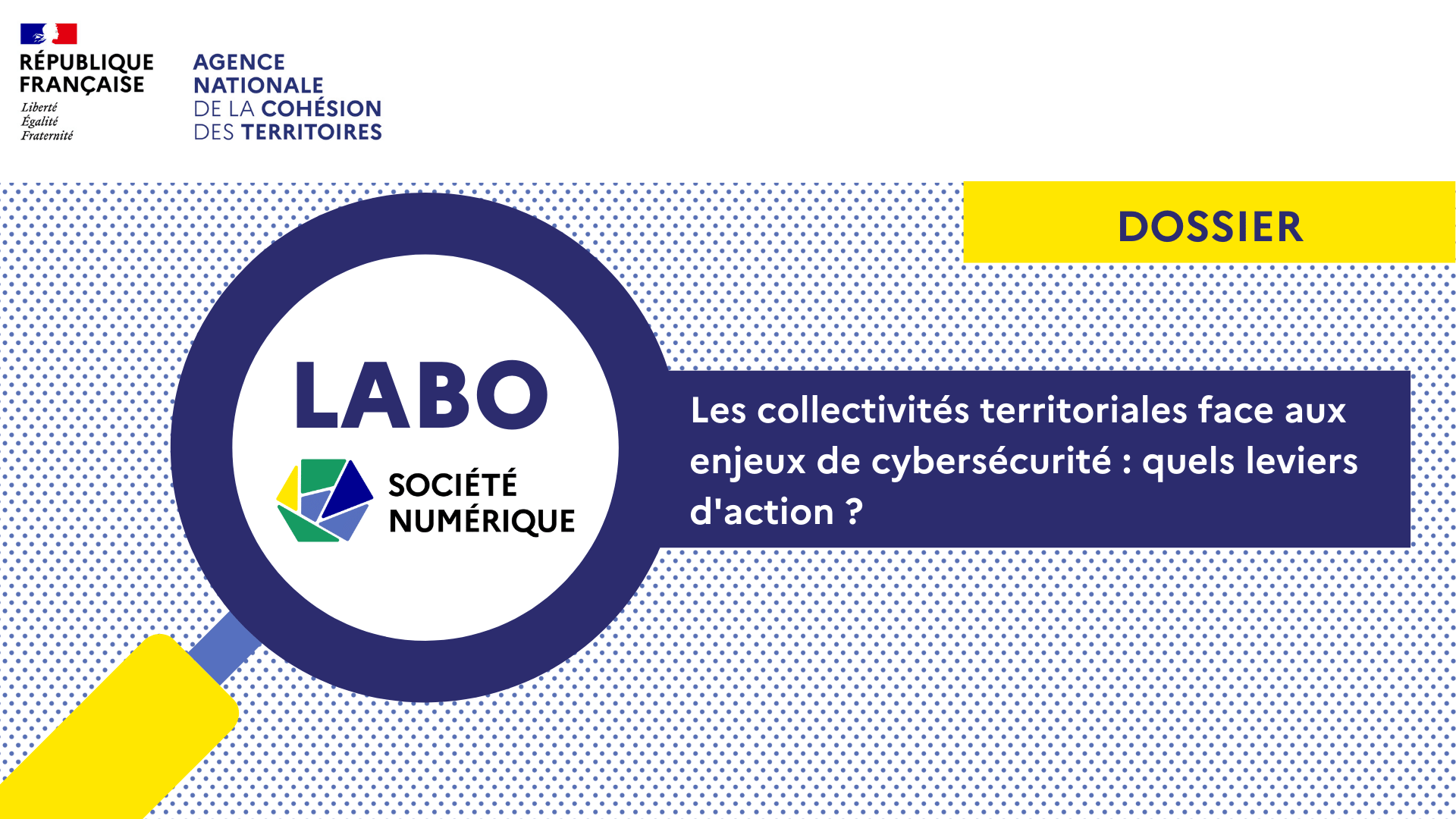
[Dossier] Territoires "intelligents" : quels objectifs, quelles valeurs, quel cadre stratégique ?

Plus de 28 000 délégué.e.s à la protection des données (DPO) : mieux intégré.e.s, motivé.e.s mais insuffisamment formé.e.s


Gouvernance, usages, souveraineté, RGPD, risques cyber : comment les collectivités gèrent leurs données ?
Depuis quelques années, les projets de "territoires intelligents" se multiplient. Des appels à projets nationaux incitent les collectivités à organiser la collecte et l’utilisation massive des données au service des politiques publiques, y compris en ayant recours à l’intelligence artificielle. Alors que les risques cyber sont plus forts que jamais, la question de la souveraineté numérique préoccupe de plus en plus les collectivités : choix des éditeurs de logiciels, hébergement des données en Europe ou en France, maîtrise des données par la collectivité…
Deux ans après sa création, l’Observatoire Data Publica, vient de publier, en partenariat avec l’Institut Ipsos, une enquête menée auprès de plus de 300 élu.e.s, cadres numériques (SI, SIG, data) ou autres DPO (délégués à la protection des données) représentant 277 collectivités, qui vont de la grande à la petite commune, en passant par la région, le département, la métropole, l’EPCI ou le centre de gestion.
Avec ses partenaires (la Banque des Territoires, l’ANCT, le Groupe La Poste, La Gazette), l’Observatoire Data Publica a souhaité comprendre et mesurer la manière dont les collectivités appréhendent les multiples enjeux liés à la gestion des données :
- La définition de priorités et de stratégies ;
- La prise en compte d’enjeux juridiques ou éthiques ;
- Les choix technologiques et notamment la cybersécurité ou encore le recours à l’IA ;
- La gouvernance, l’organisation de la gestion et le management de la donnée ;
- La transparence et la démocratie ;
- La sobriété numérique.
Référence :
Les collectivités locales et le règlement européen, un effet de taille important
72% des collectivités locales au moins partiellement en conformité avec le règlement européen.
26% des collectivités estiment être en conformité avec le RGPD (règlement général sur la protection des données), et 46% en voie de l’être.
L’effet taille est important :
- 89% des métropoles, 100% des régions ou encore 100% des communes de plus de 100 000 habitants s’estiment déjà en conformité ou en voie de l’être.
- 19% des communes de moins de 3 500 habitants estiment ne pas être encore engagées dans une démarche de mise en conformité. Seuls 61% s’estiment en conformité ou en voie de l’être.
- Seuls 26% des départements s’estiment en conformité avec le RGPD (et 52% en voie de l’être).
86% des collectivités ayant répondu à l’enquête déclarent avoir nommé un DPO dont 53% en interne, 13% de façon mutualisée avec d’autres collectivités et 20% en ayant recours à un prestataire.
100% des métropoles, des régions et des communes de plus de 100 000 habitants ont désigné un DPO, ainsi que 96% des départements. Ces chiffres sont cohérents avec les données publiées par la CNIL.
En revanche, 30% des communes ayant répondu à l’enquête ayant moins de 3 500 habitants déclarent ne pas avoir désigné de DP. « Ce chiffre est probablement inférieur à la réalité dans l’ensemble de la strate puisque 66% des communes de moins de 3 500 habitants n’ont pas de DPO ».
Au-delà de la désignation d’un DPO, la mise en œuvre du RGPD est un processus qui nécessite une adaptation des règles de gestion des données au sein de la collectivité :
- 59% des collectivités déclarent avoir modifié ce processus. Ce pourcentage atteint 83% pour les métropoles et 80% pour les régions.
- 34% des communes (et 43% des communes de moins de 3 500 habitants) déclarent ne pas avoir changé leurs méthodes de gestion des données personnelles.
50% des collectivités interrogées ont mis en place des clauses juridiques sur la gestion des données
Ces clauses concernent prioritairement la mise en œuvre du RGPD dans 96% des cas.
Ces clauses concernent aussi la maîtrise publique des données (58 %), la publication des données en open data (44 %) ou encore le respect de standards imposés par la collectivité (34%).
« L’existence de clauses sur des formats et des standards de données, indicateur de forte maturité sur la data, concerne très majoritairement les régions (44 %) et surtout les grands EPCI (46 %) et les métropoles (56%). Le sujet et ses implications juridiques sont le plus souvent identifiés par des territoires engagés dans des projets de « territoire intelligent » et confrontés directement à des enjeux d’interopérabilité ».
De nouveaux usages des données orientés en premier lieu vers la gestion administrative
« L’utilisation des données offre aux collectivités la possibilité d’améliorer l’efficacité de certaines politiques publiques. Ces cas d’utilisation sont multiples (éclairage intelligent, ramassage connecté des déchets, régulation du trafic…). Elle offre aussi la possibilité d’améliorer la connaissance du territoire, d’évaluer les politiques publiques ou encore de créer de nouveaux services aux usagers ».
36% des collectivités déclarent avoir engagé ces deux dernières années une (ou des) expérimentation(s) autour des données
Le facteur taille est déterminant. Ont réalisé des expériences, tests, POC ou prototypes au cours des deux dernières années : 90% des régions, 89% des métropoles, 57% des communes de plus de 100 000 habitants et 56% des départements.
- Le gestion administrative (dématérialisation des processus de gestion) figure en tête des nouveaux usages de la donnée : mentionné par 65% des collectivités, cet usage concerne toutes les strates de collectivités, y compris les plus petites.
- 60% des collectivités attendent des innovations grâce aux données pour la mobilité.
- Viennent ensuite l’aménagement du territoire (59%), la gestion de l’environnement (58%), la gestion du patrimoine (49%), la citoyenneté (48%), la gestion des déchets (44%)
- « Quant au sujet de la sécurité, pour lequel l’usage de la donnée est parfois polémique et décrié, il ne retient l’attention que de 37% des collectivités ».
La priorité des collectivités qui veulent accroître leur utilisation des données n’est pas le retour immédiat sur investissement
- Seules 8% des collectivités attendent en priorité un retour immédiat sur investissement (ROI) et ceci vaut quelle que soit la taille de la collectivité.
- 49% des collectivités attendent du recours plus important aux données un impact sur la relation aux usagers. Ce « retour sur les usages » est la première priorité pour les départements (59%) et les communes (57%).
- 44% des collectivités classent en première priorité les retombées sur l’efficacité des politiques publiques (ROP). C’est très majoritairement le cas des régions (70%) et des EPCI (61% pour les métropoles et 58% pour les EPCI hors métropoles).
La gouvernance des données, première étape vers une stratégie de la donnée
« L’utilisation de plus en plus massive des données implique souvent de mettre en place une gouvernance de la donnée, c’est-à-dire un ensemble de règles et de principes concernant la collecte, le stockage et le traitement des données. Par exemple, certaines collectivités imposent un hébergement local des données, définissent le format de certaines données, proposent des conventions avec des règles d'accès et de confidentialité... ».
L’introduction de règles de gouvernance de la donnée est une réalité dans 25 % des collectivités Et pour l’essentiel dans les plus grandes (et les plus expérimentées) 60% des régions, 57 % des communes de plus de 100 000 habitants, 44% des métropoles et 41% des départements.
« Ces chiffres montrent, commentent les concepteurs de l’Observatoire, qu’il y a une étape importante qui reste à franchir y compris dans les grandes collectivités, pour passer des premiers essais à la mise en place de véritables stratégies territoriales de la donnée. Cette étape est celle de la construction d’une gouvernance data ».
Seules 10% des collectivités ont associé des citoyens à la définition de règles de gouvernance de la donnée
Ces rares démarches de participation citoyenne sont aujourd’hui principalement le fruit de collectivités pionnières, en l’occurrence presque exclusivement des métropoles : 38% des métropoles déclarent associer les citoyens / la société civile à la définition de travaux sur la gouvernance des données.
Parmi elles figurent Nantes (panel citoyen pour l’élaboration de la charte métropolitaine de la donnée), Brest (organisation d’une conférence de consensus sur la donnée), Dijon (comité métropolitain de la donnée), Rennes (implication citoyenne dans le projet RUDI) ou encore Lyon , Lille ou La Rochelle (démarches de self data).
Seules 6 % des collectivités ont mis en place une charte éthique de la donnée
34% des collectivités, toutefois envisagent d’en adopter une, qu’elles élaboreront elles mêmes ou déclineront à partir d’un modèle existant.
Parmi ces dernières, les métropoles arrivent en tête (67% expriment le souhait d’adopter une telle charte) suivies par les régions (66%).
Un niveau d’acculturation des collectivités aux enjeux data jugé encore très insuffisant
65% des répondants estiment que les enjeux de la donnée ne sont pas identifiés ou insuffisamment compris dans la collectivité.
Seuls 7% estiment que le niveau d’acculturation aux enjeux data est bon.
Malgré l’expérience acquise et la maturité accumulée au fil des ans, les collectivités, y compris les grandes, estiment le niveau de culture de la donnée insuffisant (ou le sujet ignoré). C’est le cas dans 40% des régions, 45% des métropoles et 60% des autres EPCI. Le chiffre atteint 76% globalement dans les communes.
« Ces chiffres tendent à montrer que la question de la « culture data » reste très importante , y compris dans les grandes collectivités ayant le plus d’expérience. Ceci peut sans doute s’expliquer par le fait que les projets data restent très majoritairement pilotés par de petites équipes voire des experts isolés, sans que la culture data ne se diffuse encore suffisamment autour d’eux ».
Des outils de traitement et d’analyse de données en place ou en cours de déploiement dans 49% des collectivités
C’est le cas très massivement dans les métropoles (94%), les régions (90%), les villes de plus de 100 000 habitants (86%) les départements (81%). Seules les communes de moins de 3500 habitants sont très en retrait avec 10% de recours à ces outils.
Les sujets de la standardisation des données et de l’interopérabilité sont pris en compte par moins de 40% des collectivités interrogées parmi lesquelles figurent essentiellement les métropoles (respectivement 83% et 89% ) et les régions (respectivement 70% et 90%). Ceci s’explique à la fois par une plus forte maturité sur la donnée, la nature des compétences et les modes d’exploitation, et un besoin accru de proposer des systèmes qui puissent dialoguer avec des outils infra ou extra territoriaux.
La mise en place de capteurs et de réseaux IdO (Onternet des Objets) concerne 25% des collectivités interrogées. Ce chantier est fortement mis en avant par les métropoles : 85% d’entre elles en déploient, essentiellement dans leurs démarches de "territoire intelligent".
L’installation d’un lac de données est une solution peu identifiée. Elle concerne 13 % des collectivités parmi lesquelles on compte principalement les communes de plus de 100 000 habitants (58 %).
La souveraineté numérique s’invite sur l’agenda des collectivités
« La question de la souveraineté numérique est mise en avant de façon récurrente dans les débats nationaux ou européens. Elle est aussi présente au niveau local concernant le choix d’outils ou l’hébergement La question de la maîtrise publique des données reste, toutefois, un sujet mal identifié. »
Seules 23% des collectivités ont défini des orientations sur le sujet. Les grandes collectivités se distinguent : 60% des régions et 56% des métropoles affirment avoir défini une politique de souveraineté sur les données.
49% des collectivités privilégient, lorsque c’est possible, des logiciels français ou européens
« Cette tendance est comparable quelle que soit la strate administrative concernée ce qui tend à montrer que les préoccupations liées à la souveraineté numérique sont présentes à tous les niveaux ».
Le choix systématique de l’open source n’est fait que par 7% des collectivités. Il peut être ponctuel (dans 30% des cas mais dans 38% des cas, la collectivité n’en fait pas un critère de sélection Ce choix est toutefois retenu à 57% dans les communes de plus de 100 000 habitants et à 50% dans les régions et les métropoles.
62% des collectivités gèrent leurs données sur des serveurs internes
A l’opposé des discours ambiants sur le recours au cloud, une très grande majorité (62%) de collectivités privilégie l’hébergement sur des serveurs internes. C’est le cas pour 85% des départements 58% des communes, pour 67% des métropoles 56% des communes de moins de 3 500 habitants.
L’hébergement dans un « cloud » sécurisé (labellisé SecNum par l’État) est une option identifiée mais rarement privilégiée, sauf par 14% des communes et 7% des métropoles.
Seules les régions se distinguent : elles recourent à 40 % à un serveur interne et à 30% à des centres de données publics locaux.
L’hébergement des données à distance via le recours à des logiciels en Saas représente le 2ème mode d’hébergement le plus utilisé (13%).
89 % des collectivités s’estiment exposées à des risques cyber
« Comme toutes les organisations, les collectivités territoriales sont concernées par les enjeux de sécurité des systèmes d’information. Depuis 2 ou 3 ans, celles qui ont été la cible d’attaques spécifiques, pouvant totalement bloquer leurs services, rapportent des pertes financières, une perte de temps et une perte de confiance de leurs administrés ».
89% des collectivités s’estiment exposées à des risques cyber et 57% estiment que cette exposition est continue ou fréquente. Seules les petites communes relativisent ce risque : 26 % des communes de moins de 3 500 habitants estiment ne pas être exposées. A l’inverse 100% des régions, des départements, des métropoles et des communes de plus de 10 000 habitants ont pris conscience du danger.
Ces chiffres progressent très rapidement. Une étude réalisée pour le compte de la FNCCR en avril 2021 montrait que 56 % des collectivités de plus de 100 000 habitants s’estimaient fréquemment ciblées Elles sont 86% en 2022.
24 % des collectivités estiment que le niveau de prise en compte du risque est bon. Ce chiffre atteint 67% dans les métropoles et 50 %dans les régions. Le sujet n’est « pas identifié » dans 13% des collectivités.
De façon très claire, la taille de la commune influe sur la prise en compte du risque. En effet, le sujet n’est pas traité ou l’est de façon insuffisante dans 62% des communes de moins de 3 500 habitants, dans 35% de celles de 3 500 à 10 000 habitants, dans 33% de celles entre 10 000 et 100 000 habitants mais aussi dans 26% des départements, 20% des régions et 6% des métropoles.
Les obstacles à la prise en compte et à la diffusion des outils de cybersécurité sont multiples, manque de temps (47%), manque de compétences (46%), manque de budgets (44%), difficultés de recrutement (17%).
Les collectivités engagées dans une démarche de cybersécurité le font avec méthode et mobilisent l’arsenal des bonnes pratiques. Les pourcentages de mise en œuvre sont proportionnels à la taille des collectivités : 100 % des métropoles, 80% des régions ou 71% des communes de plus de 100 000 habitants ont désigné un responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) contre 13% des communes de moins de 3 500 habitants et 29% de celles de 3 500 à 10 000 habitants.
Des stratégies de numérique responsable en cours d’élaboration
A partir de 2025 les collectivités de plus de 50 000 habitants devront adopter une stratégie numérique responsable.
Pour 33% des collectivités, une stratégie numérique responsable est en cours d’élaboration ou a déjà été adoptée, et de manière très importante par les régions (80%) et les métropoles (72%). L’enquête a été administrée avant la parution du décret du 29 juillet 2022 précisant les obligations à venir pour l’élaboration d’une stratégie numérique responsable pour les communes et EPCI de plus de 50 000 habitants.
Labo Société Numérique



Suivez-nous
sur les réseaux sociaux

