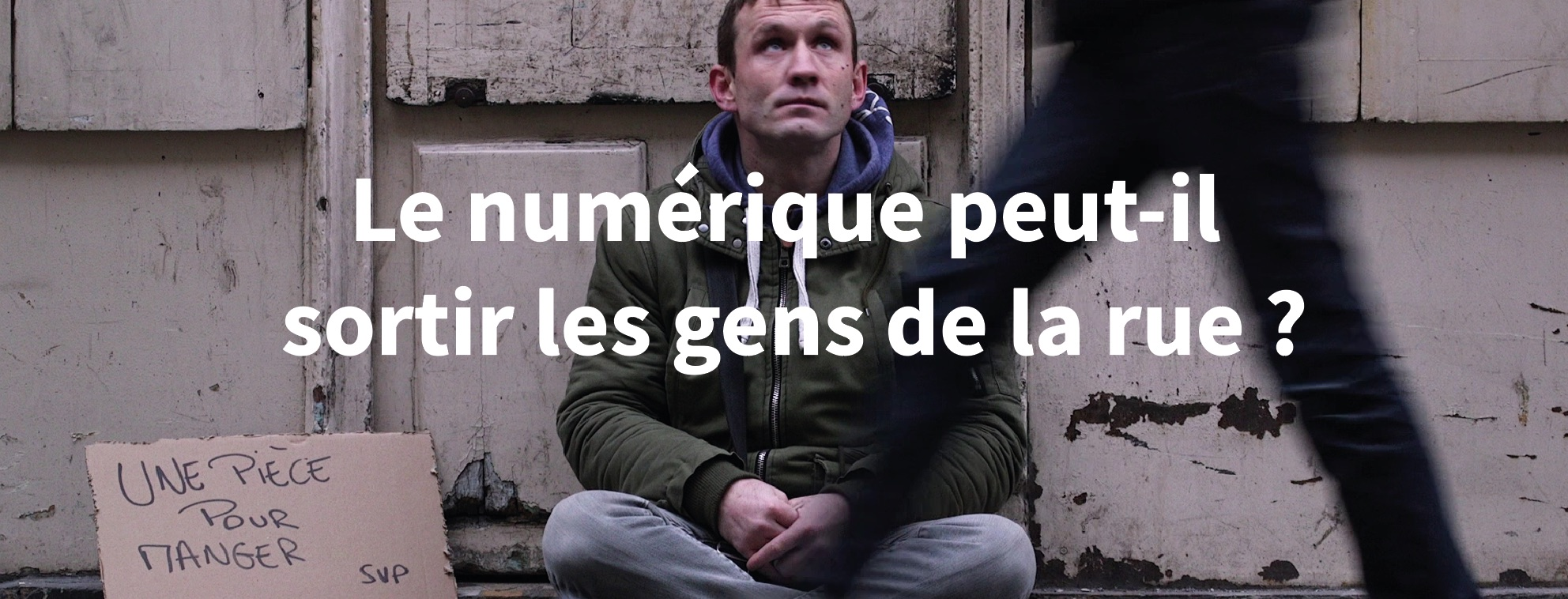La question de l’accès au numérique des personnes sans abri donne lieu depuis quelques années à toute une série d’initiatives : « coffre-fort numérique » qui permet aux personnes sans abri de conserver leurs papiers d’identité, recensement en ligne des adresses et services utiles comme l'accueil de jour, les distributions alimentaires à proximité ou les bains-douches) ou encore la mise à disposition téléphones mobiles…
L’INSEE évaluait en 2012 à 143 000 le nombre de personnes sans-domicile (il s’agit de personnes ayant eu recours à un service d’hébergement ou ayant dormi dans un lieu non prévu pour l’habitation la nuit précédente) : leur nombre s’était accru de 50 % entre les deux études de l’Insee de 2001 et 2012. Les personnes sans abri sont en majorité des hommes mais la part de femmes et d’enfants progresse et représenterait un peu plus d’un tiers des sans-domicile (37 %). L’âge moyen en 2012 était de 39 ans mais ils étaient de plus en plus nombreux à avoir plus de 60 ans (10 % des sans-domicile en 2012). 62 % des sans-domicile vivaient seuls, 17 % en couple avec un ou plusieurs enfants, 12 % seuls avec un ou plusieurs enfants et 9 % en couple sans enfant.
Selon un stéréotype largement partagé, les personnes à la rue n’ont pas accès aux technologies numériques ou n’ont pas les compétences nécessaires pour en tirer parti quand elles en disposent. C’est loin d’être le cas.
La Social Good Week 2018 avait, d’ailleurs, consacré une table-ronde aux pratiques numériques des personnes SDF autour de la question « Le numérique peut-il sortir les gens de la rue ? ». Les participants avaient observé, à cette occasion, que les personnes SDF « par leurs pratiques et par leurs besoins, font bouger de l’intérieur les associations dans leur transformation numérique ».
Référence :
Le téléphone mobile, outil de gestion quotidienne de la survie
Dans le cadre sa thèse, consacrée à l’Ethnographie des pratiques numériques des personnes à la rue, Marianne Trainoir a passé environ une année en immersion dans quatre structures d’accueil de jour. Elle a mené des entretiens biographiques avec quarante-cinq personnes connaissant ou ayant connu la rue. Elle s’attache à comprendre comment les pratiques numériques contribuent à cette lutte quotidienne que mènent les personnes sans abri « pour le maintien de soi »
Les sociabilités numériques observées par Marianne Trainoir concernent en premier lieu les relations amicales de la rue. « Au-delà des dialogues interpersonnels (écrits et oraux), les correspondances numériques prennent la forme de statuts et de commentaires qui deviennent des correspondances publiques ou semi-publiques. À travers ces messages plus ou moins directement adressés, les enquêtés partagent leurs goûts, leurs humeurs, leurs joies, leurs colères, leurs loisirs et leurs préoccupations (...) Les réseaux sociaux sont, pour certains, un nouvel espace où relayer des combats parfois peu investis dans le quotidien. Les personnes qui ont les sociabilités numériques les plus actives sont celles qui sont très engagées dans la culture de la rue ».
Les outils numériques permettent, en outre, maintenir des liens familiaux. Ce sont, en effet, « les carences dans les sociabilités familiales qui créent le sentiment de solitude le plus douloureusement ressenti. Si les rapports téléphoniques sont souvent conflictuels, les réseaux sociaux permettent de réintroduire de la distance notamment grâce à l’absence de la voix et à la possibilité d’échanger de manière asynchrone. Pour les plus jeunes, les comptes sur les réseaux sociaux constituent alors un espace « concédé » à la famille, notamment à la mère, pour lui permettre de jouer son rôle ».
Les pratiques numériques visent également l’affiliation à un monde social commun. Les enjeux sont d’« être à la page » et d’« être au courant ». Certaines pratiques observées se justifient donc par la crainte d’apparaître marginal (...) Ne pas trouver d’utilité à une technologie socialement valorisée et dont on sait par ailleurs que beaucoup de personnes l’utilisent quotidiennement provoque un réel sentiment de relégation notamment chez les plus jeunes qui ont intériorisé l’idée que cela devrait « naturellement » faire partie de leur quotidien. Ils expérimentent alors un sentiment de culpabilité et de dissemblance radicale ».
Par ailleurs, « sans que cela ne semble découler de soucis techniques, les démarches administratives médiatisées mettent souvent les personnes à la rue dans l’embarras. Elles utilisent alors volontiers les équipements (ordinateur connecté, téléphone) des structures d’accueil afin de réaliser leurs démarches en s’assurant de la présence d’un tiers de confiance et du bénéfice d’un environnement sécurisant. Les interactions avec l’aide sociale, foncièrement inégalitaires et souvent empreintes d’incompréhension, sont toujours vécues comme stigmatisantes. Elles participent à une forme de réduction de la personne à ses carences et à ses empêchements. Elles alimentent une fatigue, physiquement et moralement ressentie, qui est ainsi combattue en se concentrant sur autre chose notamment les pratiques de divertissement et de sociabilités ».
Référence :
Grande diversité des usages numériques chez le public sans-abri
L’association Solinum, à l’origine de projets numériques dans le domaine de l’action sociale, vient de rendre publique une étude, « Précarité connectée », réalisée auprès de 300 personnes dans 16 villes françaises.
Selon cette étude, « les personnes SDF sont majoritairement équipées de téléphones mobiles, outil devenu indispensable dans leur quotidien. En effet, 91 % des personnes interrogées possèdent un téléphone mobile et 71 % ont un smartphone ».
L’étude pointe une certaine hétérogénéité en termes d’accès et d’utilisation des outils numériques : « un panel très large d’utilisation et de compréhension du numérique chez le public sans-abri ».
- « Les personnes SDF sont confrontées à diverses problématiques qui rendent plus difficile leur accès au numérique, notamment en ce qui concerne un accès internet limité, des difficultés de rechargements, des vols d’appareils »
- « Le manque de ressources et l’absence de domiciliation ne leur permettent pas toujours de bénéficier d’un abonnement mobile. Ainsi, la plupart d’entre eux optent pour une carte téléphonique prépayée (66 %) plutôt qu’un abonnement mobile (29 %), bien que la carte prépayée ne permette pas toujours un accès à Internet ».
- « Les personnes en migration sont plus susceptibles de posséder un téléphone mobile. 78 % des répondants sans-papiers, des demandeurs d’asile, ou ayant une carte de séjour possèdent un smartphone, contre 62 % pour les personnes de nationalité française. Les demandeurs d’asile sont également ceux qui se rendent le plus souvent sur Internet et sont les utilisateurs les plus assidus des réseaux sociaux ».
- « En termes de compétences numériques, nous observons également une grande disparité selon les différentes caractéristiques sociodémographiques. Les personnes de 18 et 40 ans sont celles qui se perçoivent comme le plus à l’aise avec le numérique. Les personnes ayant fait des études supérieures sont également davantage à l’aise avec le numérique. Enfin, les répondants étant en situation de précarité depuis 1 à 5 ans se sentent davantage à l’aise que les personnes à la rue depuis plus longtemps ».
- « Concernant la fréquence d’utilisation internet, la majorité des personnes interrogées utilisent Internet régulièrement. Plus de la moitié des répondants (55 %) s’y rend tous les jours. Toutefois, ils sont 17 % à déclarer ne jamais s’en servir, principalement parce qu’ils manquent de compétences (60 %) ».
- « 62 % des personnes interrogées ne font jamais leurs démarches administratives en ligne. La plupart de nos répondants utilisent Internet tous les jours ou presque, principalement pour se divertir : regarder des films ou écouter de la musique (40 %), aller sur les réseaux sociaux (37 %), ou encore s’informer sur l’actualité (24 %) ».
Précarité Connectée : 6 recommandations pour l’inclusion numérique des sans-abri
Solinum formule, en conclusion, une série de recommandations visant à améliorer les conditions de vie des personnes sans-abri.
- Proposer un accompagnement numérique adapté et des formations gratuites.
- Mettre à disposition des équipements numériques publics adaptés aux pratiques et besoins des personnes SDF.
- Déployer des points de rechargement de batteries accessibles à tous.
- Améliorer l’accès à Internet dans les structures sociales (mise en place du wifi dans les centres d’hébergement, installation d’ordinateurs en libre service…).
- Proposer des offres mobiles et équipements à des tarifs solidaires.
- Faciliter les démarches en ligne en les rendant plus ergonomiques et accessibles à tous quels que soient leurs compétences numériques ou le niveau d’éducation .
Référence :
Soliguide réunit les informations indispensables pour les personnes sans abri

Afin de redonner l’autonomie aux personnes sans-abri et réfugiés, Soliguide cartographie sur son site Internet tous les lieux indispensables à la vie quotidienne d’un SDF : où poser ses bagages, où manger, où se laver, où se faire soigner, où trouver un accès Internet, etc. Soliguide centralise ainsi plusieurs milliers de lieux et de services à Paris, Nantes et Bordeaux, dans les départements des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis ont été cartographiés par l’association.
Deux bornes interactives de Soliguide, installées en juin dernier, permettent de s'orienter à Bordeaux.
Référence :
Entourage : un réseau social de solidarité et de mise en relation des personnes sans abri avec les riverains

À la rue, c’est l’isolement qui déshumanise. L’association Entourage a mis au point une application mobile qui favorise la mise en relation des personnes sans abri avec voisins de leur quartier. L’association fait état de 60 000 participants actifs sur l'application : associations, habitants soucieux d’agir à leur niveau contre la solitude des personnes SDF et personnes SDF.
Impliqué dans l’élaboration du contenu de la plateforme, Alain Mercuel, psychiatre et responsable de l’équipe mobile Santé mentale et exclusion sociale (SMES) du centre hospitalier Sainte-Anne, à Paris, estime quant à lui que l’action des habitants peut compléter celle des soignants auprès des sans-abri souffrant de troubles psychiques. « L’important est de créer du lien durable. C’est la répétition des rencontres qui va encourager la personne a, un jour, demander de l’aide, et c’est cette humanité, ce liant, qu’amène un riverain par rapport à d’autres acteurs, qu’ils soient professionnels ou bénévoles».
Entourage a conclu en avril 2019 un partenariat avec l'Institut Randstad pour la mise en place d’une plateforme numérique d’aide aux personnes SDF à la réinsertion par l’emploi : Entourage Job.
Références :
Un coffre-fort numérique pour les personnes en situation de précarité
Le coffre-fort numérique est un service sécurisé en ligne qui permet aux personnes de conserver leurs documents administratifs et/ou personnels (carte d’identité, permis de conduire, contrats, factures, relevés, photos, etc.) et d’y accéder via Internet. L’utilisateur choisit la nature des documents qu’il souhaite conserver dans cet espace qui lui est personnel.
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et l’Union Nationale des Centres Communaux et intercommunaux d’Action Sociale (UNCCAS) ont lancé en juillet 2016 une expérimentation visant à évaluer l’usage et l’utilité du coffre-fort numérique, à la fois auprès des personnes accompagnées mais aussi des agents des CCAS dans le cadre de leurs missions.
Cette expérimentation a été mise en oeuvre dans 16 centres d’aide sociale : elle visait à comprendre dans quelles conditions le coffre-fort numérique pourrait faciliter l’accès aux droits et à l’accompagnement social des personnes concernées en luttant contre la perte de leurs documents, et dans quelle mesure il pourrait être également un outil efficace de lutte contre la fracture numérique.
- Cinq offreurs de solutions de coffres-forts numériques s’étaient portés volontaires pour participer à cette expérimentation.
- Plus de 200 agents concernés avaient été formés et sensibilisés au coffre-fort numérique
- En un an, près de 3 000 personnes se sont vues proposer l’ouverture d’un coffre-fort numérique (dont 1 000 ont été effectivement ouverts).
A l’occasion de la Journée nationale « Cohésion sociale et numérique », la DGCS et l’UNCASS ont présenté les résultats de cette expérimentation.