Avant-Propos
Deux sujets dominent l’actualité du numérique éducatif en cette rentrée scolaire : l’encadrement des usages du numérique à l’école avec, notamment, la généralisation de de la « pause numérique » au collège (rebaptisée « portable en pause ») et l'appropriation de l’intelligence artificielle par le système éducatif. Le ministère de l’éducation nationale a rendu public un cadre d’usage de l'intelligence artificielle en éducation. Il a annoncé en février 2025 le développement d’une IA souveraine pour soutenir les enseignant.es dans leurs pratiques quotidiennes et la création d’un parcours Pix dédié à l’intelligence artificielle pour les élèves du 2nd degré.
En cessant de financer les manuels papier et en réduisant son budget pour les manuels numériques traditionnels, au profit de contenus conçus spécifiquement pour la plateforme numérique Pearltrees, la région Ile-de-France a réactivé le débat sur l'utilisation des manuels numériques et des manuels traditionnels, leur financement et leur gouvernance : un débat qui traverse et divise la communauté éducative.
La réflexion autour du numérique éducatif a été marquée, en outre, par la publication de trois rapports :
- La Cour des Comptes s’est penchée en 2025 sur l’enseignement primaire. Elle consacre un chapitre de son rapport au déploiement du numérique. La Cour des Comptes y revient sur les politiques d’équipement des écoles et les dispositifs mis en place. « Malgré toutes ces démarches qui visent à définir une stratégie concertée entre État et collectivités et qui témoignent d’un souci de l’appropriation des ressources par les enseignants, de nombreuses défaillances apparaissent en matière de développement du numérique dans l’enseignement du premier degré ».
- Dans le rapport qu’elle consacre aux usages du numérique dans la relation École-familles, l’Inspection générale de l’éducation du sport et de la recherche (IGESR) dresse un bilan plutôt positif des espaces numériques de travail (ENT). Elle s’inquiète, toutefois, de la position quasi-monopolistique d'un éditeur privé sur le marché des logiciels de vie scolaire. L’inspection alerte sur l'usage intensif des ENT et logiciels de vie scolaire notamment en dehors du temps scolaire. Elle recommande la mise en œuvre d'un droit à la déconnexion (pas de nouvelles publications entre 20h et 7h, ni durant les week-ends et vacances). Alors que les familles les plus éloignées du numérique rencontrent des difficultés d'accès ou de compréhension des ENT, l’Inspection recommande de mobiliser, dans le cadre d’une « alliance éducative » les collectivités locales, les associations, les conseillers numériques, les France Services, les caisses d'allocations familiales, pour maintenir et développer, dans l’ensemble des territoires, l'accompagnement des familles.
- Cette même inspection générale a rendu en juin 2025 un rapport sur l’intelligence artificielle dans les établissements scolaires. Elle y recommande la mise en place rapide d’un plan de formation massif à destination des cadres ainsi que la mise en place rapide de « formations en présentiel dans tous les établissements pour initier au plus vite tous les enseignants aux enjeux et aux usages premiers de l’IA en éducation ». L’inspection appelle à « la construction d’un discours national » autour de l’IA articulant numérique et pédagogie, « permettant un déploiement équitable sur l’ensemble du territoire ».
L’Inspection générale relève, dans ce rapport, un certain nombre de contradictions dans « le discours national » tenu sur l’IA par l’institution, au premier rang desquelles « une contradiction entre la nécessité de former les élèves à l’IA et de respecter une « pause numérique ». Une contradiction « qui, au moins dans les termes, crée une incertitude sur l’usage de certains outils numériques avec les élèves (notamment dans le 1er degré où la pause numérique est largement comprise comme un arrêt de l’usage des écrans avec les élèves) ».
IA dans l’enseignement : un besoin rapide de formation à tous les niveaux, un discours national cohérent à construire
L’Inspection générale de l’éducation du sport et de la recherche (IGESR) a rendu en mai 2025 un rapport sur l’intelligence artificielle dans les établissements scolaires. Le rapport est organisé en trois parties : la première dresse un état des lieux de la place de l’IA dans les établissements scolaires. Cet état des lieux repose sur une enquête de terrain et une consultation (4 943 enseignant.es de cinq académies y ont pris part). La deuxième partie se penche sur l’intégration de l’IA dans l’enseignement et les enjeux de formation élèves, enseignant.es et cadres). La troisième partie aborde la question du pilotage de l’IA dans le système éducatif.
L’inspection s’efforce d’identifier « des champs d’action à investir rapidement » (le terme « rapide » revient 35 fois).
Un besoin rapide de formation à tous les niveaux pour une prise en main raisonnée de l’IA en éducation
« Quel que soit le public interrogé (élèves, enseignants, cadres), tous soulignent le manque de formation comme un frein majeur. L’effervescence médiatique renforce, chez certains acteurs, le sentiment d’être déjà dépassé ».
La mission recommande la mise en place rapide d’un plan de formation massif à destination des cadres ainsi que la mise en place rapide de « formations en présentiel dans tous les établissements pour initier au plus vite tous les enseignants aux enjeux et aux usages premiers de l’IA en éducation ».
« La question de l’IA étant amenée à évoluer rapidement, l’échelon de l’établissement apparaît comme l’échelon à privilégier afin de permettre un plan de formation pluriannuel, l’échange de pratiques au sein des équipes et l’élaboration d’un discours et d’une stratégie commune en matière d’IA dans chaque établissement ».
Côté élèves, même si les réticences sont moins fortes, « le besoin d’une formation, d’un cadre et d’un guidage de la part du corps enseignant est exprimé clairement. La mission recommande la mise en place rapide d’un curriculum de formation à l’IA permettant à la fois la formation de futurs spécialistes et l’éducation de tous les élèves aux enjeux et usages de l’IA. Un tel curriculum doit s’appuyer sur toutes les disciplines scolaires ».
Un besoin rapide de coordination à tous les niveaux pour un déploiement équitable sur le territoire
De multiples initiatives autour de l’IA se développent aujourd’hui dans les établissements, dans les académies et au niveau de l’administration centrale : « Celles-ci restent cependant trop souvent dépendantes de l’impulsion d’une personne (enseignant.e ou cadre) engagée personnellement dans ces thématiques. Il est essentiel de mieux coordonner ces initiatives afin d’en permettre la mutualisation mais aussi l’évaluation pédagogique et l’impulsion sur l’ensemble du territoire.
L'inspection dresse le constat d'une « gouvernance de l’IA encore trop éparpillée » et de tensions « entre un fonctionnement traditionnellement centralisé, une réalité administrative aujourd’hui déconcentrée. Elle pointe auss l’existence de doublons. Ceux-ci sont particulièrement visibles dans le domaine de la formation des agents qui se développe sans pilotage coordonné entre l’administration centrale (DNE, DGESCO, IGÉSR), les opérateurs nationaux (Réseau Canopé, France Université Numérique) et les acteurs académiques ».
L'inspection générale recommande la mise en place rapide d’instances de coordination à différents niveaux :
- A l’échelon de l’établissement : c’est à ce niveau que peuvent s’opérer des choix stratégiques adaptés au public accueilli et aux spécificités locales ;
- Au niveau académique, pour suivre le déploiement rapide du plan de formation, du curriculum IA et de la stratégie IA dans les établissements ;
- Au niveau national, avec la mise en place d’un conseil national de l’IA regroupant les acteurs de l’administration.
Le besoin d’un modèle économique pérenne
La question des outils, et notamment celle de la mise à disposition d’outils souverains, est une attente forte sur le terrain. « Dans ce contexte, la stratégie adoptée au sein de l’Éducation nationale vise à encourager des usages souverains et conformes à la réglementation sans interdire l’utilisation d’outils grand public auxquels ont déjà recours les élèves ».
Des questions subsistent néanmoins au vu du coût d’utilisation des outils, grand public ou spécifiquement développés pour l’éducation. « L’Éducation nationale a en effet encouragé le développement d’une filière EdTech via les expérimentations P2IA qui ont permis la création d’outils spécifiques (…) souvent plébiscités par les enseignants expérimentateurs mais dont la plus-value reste à établir. En outre, le financement du déploiement à grande échelle et à long terme de ces outils n’est aujourd’hui pas garanti ».
Un discours national cohérent à construire
L’Inspection se montre incisive quand elle pointe une série de contradictions dans « le discours national ».
« Le manque de coordination entre pilotage du numérique et pilotage du pédagogique au niveau national, couplé à une difficulté d’un pilotage en contexte incertain (notamment en raison de la volatilité des technologies) » se traduisent par une série de contradictions.
- « une contradiction entre la nécessité de former les élèves à l’IA et de respecter une « pause numérique » qui, au moins dans les termes, crée une incertitude sur l’usage de certains outils numériques avec les élèves (notamment dans le 1er degré où la pause numérique est largement comprise comme un arrêt de l’usage des écrans avec les élèves) ;
- une contradiction entre la nécessité de former les élèves à l’IA et un retour aux fondamentaux, souvent assimilé à un enseignement construit sur les méthodes « traditionnelles » considérées comme plus efficaces par un nombre significatif d’acteurs de terrain ;
- une contradiction entre le déploiement de l’IA, ses conséquences écologiques et une éducation au développement durable dans une école faisant le choix d’utiliser des technologies énergivores ;
- une contradiction entre l’injonction de la nécessité de former les élèves à l’IA et l’absence d’outils souverains »
L’inspection appelle à « la construction d’un discours national cohérent permettant d’apporter une ligne claire entre ces différentes contradictions ». Il appartiendrait au conseil national de l’IA d’élaborer « ce discours commun autour de l’IA articulant numérique et pédagogie et permettant un déploiement équitable sur l’ensemble du territoire ».
Référence :
Ce que prévoit le Cadre d'usage de l'IA en éducation
Le ministère de l'Éducation nationale a publié le 14 juin 2025 un cadre d'usage de l'intelligence artificielle en éducation, fruit d'une consultation menée de janvier à mai 2025. Ce document encadre pour la première fois les usages pédagogiques et administratifs des IA génératives dans l'enseignement.
Le Cadre d'usage autorise l’utilisation de l'IA sous réserve d'un strict respect des valeurs de l'École de la République, des obligations légales (RGPD, loi SREN, règlement européen sur l'IA).
Il fixe quelques principes :
- « L'utilisation de l’IA doit se faire de manière responsable et réflexive, en s’appuyant sur l’expertise professionnelle des personnels qu’elle peut assister, mais jamais remplacer.
- « l’IA ne doit être utilisée que si aucune autre solution moins coûteuse écologiquement ne répond de façon satisfaisante au besoin ».
- « L’utilisation des solutions libres doit être privilégiée ».
- « Le recours aux services d’IA accessibles au grand public est autorisé sous réserve qu’aucune donnée confidentielle ou à caractère personnel ne soit utilisée ».
- « Aucun membre du personnel ne doit demander aux élèves d’utiliser des services d’IA grand public impliquant la création d’un compte personnel ».
- « L’usage de l’IA dans la prise de décision éducative, pédagogique ou administrative doit être exercé en toute transparence et responsabilité, avec une communication explicite sur son rôle et la façon dont elle a été utilisée ».
Des usages encadrés et accompagnés par l’enseignant
« Dans le cadre pédagogique, l’usage de l’IA, en assistance et non en substitution des apprentissages et de l’effort intellectuel, doit être encadré et accompagné par l’enseignant ».
Les élèves du 1er degré sont sensibilisés aux connaissances de base sur les IA, mais sans manipuler directement des services d'IA générative ».
- Dès le premier degré, les élèves sont sensibilisés aux connaissances de base sur les IA, mais sans manipuler directement des services d’IA générative.
- L’utilisation pédagogique des IA génératives par les élèves, encadrée, expliquée et accompagnée par l’enseignant, est autorisée en classe à partir de la 4e en lien avec les objectifs des programmes scolaires et du CRCN.
- Au cours de leur scolarité, les élèves reçoivent une formation obligatoire aux IA et à leurs enjeux, au moins en 4e, 2de des voies générales, technologiques et professionnelles, et en première année de CAP sur la plateforme Pix.
- Au lycée, les élèves peuvent les utiliser de manière autonome dans un cadre d’apprentissage et de formation explicitement défini par l’enseignant.
Si les enseignant peuvent proposer des séquences pédagogiques intégrant l’IA (sans manipulation d’IA générative par les élèves avant la 4e), le cadre d’usage rappelle qu’ils doivent « veiller à développer l’esprit critique des élèves sur ces technologies et leur utilisation (enjeux, potentialités, recommandations pour la rédaction des requêtes, limites et risques) ».
Pour ses tâches pédagogiques (assistance à la préparation de cours, à l’évaluation, à la correction, etc.), « tout enseignant peut utiliser des IA accessibles au grand public, sous sa responsabilité sachant que, comme toute donnée ou information utilisée à des fins d’enseignement, les productions générées par l’IA doivent être vérifiées et croisées avec d’autres sources ».
S’agissant des devoirs, le cadre d’usage précise que « l’utilisation d’une IA pour réaliser tout ou partie d’un devoir scolaire, sans autorisation explicite de l’enseignant et sans qu’elle soit suivie d’un travail personnel d’appropriation à partir des contenus produits, constitue une fraude ».
Référence :
Un engouement inquiet autour de l’IA dans les établissements scolaires
« Les pratiques individuelles, personnelles ont depuis longtemps devancé les annonces des politiques et souvent dans un sens contraire. Le monde scolaire n’échappe pas à ces contradictions qu’il vit au quotidien » observe, sur le site Café Pégagique, Bruno Devauchelle (Docteur en TIC). « D’un côté les passionnés font feu de tout bois pour proposer leur enthousiasme envers le potentiel de l’IA en éducation. D’un autre les interrogations sur les dangers, les effets, les conséquences de l’IA s’expriment de plus en plus vivement chez les enseignants ».
« Le monde de l’enseignement est d’autant plus inquiet désormais que la puissance et les propositions de l’IA sont impressionnantes et touchent au coeur du métier (…) Un élève peut revendiquer des performances scolaires nouvelles avec l’aide de l’IA. Qu’il l’utilise en réponse aux demandes et injonctions de leurs eenseignants ou qu’il l’utilise pour se développer lui-même, c’est bien le rôle et même la place de l’enseignant qui est en question. L’enseignant, quant à lui, va trouver avec l’IA des moyens d’enrichir son enseignement, soit pour les supports (textes, photos, vidéos,…), les contenus (sélection, synthèse) ou la conception de son enseignement (évaluation, progression, etc.) Qu’ils le déclarent ou non, désormais les enseignants aussi utilisent de plus en plus l’IA ».
« Former les enseigants à l’IA oui, mais comment ? » s'interroge Bruno Devauchelle. « L’affaire semble simple a priori. Dans le quotidien cela est moins évident. En premier lieu, quand les enseignants pourront-ils se former ? et si c’est hors du temps devant élève, aura-t-on recours aux webinaires (..) Notre expérience en intra, en tant qu’intervenant, nous amène à penser que cela ne sera utile que si dans l’établissement se met en place un véritable travail collectif de veille et de partage. Il s’agit d’abord que chacun entame un processus d’appropriation dont la première partie est une prise en main personnelle, mais dont la suite relève du travail de discussion et de co-élaboration à propos de la manière dont l’IA peut et devrait prendre place dans le quotidien. Les inquiétudes doivent être remplacées par un sentiment de maîtrise suffisante qui se décline aussi bien en limitations diverses qu’en utilisations pertinentes et critiques ».
« Nous ne pouvons pas ignorer l’utilisation de l’IA par nos élèves, mais nous ne saurions renoncer à notre ambition de former leur intelligence humaine ».
Le collectif Éducation numérique raisonnée, qui regroupe aujourd’hui près de trente enseignant.es et personnels de direction, appelle, dans Télérama, à une large réflexion autour de l’IA à l’école.
« Depuis quelques mois, élèves et étudiants y ont massivement recours pour déléguer leurs travaux de réflexion et de rédaction. Ce constat provoque une réelle crise de sens pour les enseignants : peut-on encore faire réfléchir les élèves par eux-mêmes lorsqu’ils ont un accès illimité, gratuit et quasi instantané à un assistant virtuel qui court-circuite toute tentative de réflexion personnelle ? » (…) Nous ne pouvons pas ignorer l’utilisation de l’IA par nos élèves, mais nous ne saurions renoncer à notre ambition de former leur intelligence humaine. Il nous faut donc les accompagner vers un usage éclairé de l’IA, pour qu’elle augmente leurs capacités intellectuelles au lieu de les atrophier. Tout l’enjeu est là ».
« Dans son document de cadrage, l’Éducation nationale tente de dessiner ce que serait ce bon usage. Elle propose des conseils généraux de bon sens, mais apparaît démunie devant l’usage réel que les élèves font de l’IA – à savoir se décharger de leur travail. De fait, pour les devoirs à la maison, il est techniquement impossible de les empêcher d’utiliser des contenus générés par l’IA. Devant cette réalité, l’Éducation nationale acte le choix de faire de l’IA un support d’apprentissage en autorisant, à partir de la quatrième, « l’utilisation pédagogique des IA génératives par les élèves, encadrée, expliquée et accompagnée par l’enseignant ».
Cependant, accepter que le cerveau humain en formation s’appuie sur des résultats générés par l’IA, même retravaillés, est dangereux à double titre.
D’une part, cette démarche menace la créativité des élèves parce qu’elle les conforte dans l’idée que, devenue incontournable, l’IA fournit la matière de base requise avant toute réflexion humaine, en gommant la singularité et la diversité de leurs propres cheminements. (…) D’autre part, cette démarche demande aux élèves une prise de recul dont ils ne sont souvent pas capables. Pour passer au crible de l’esprit critique les résultats générés par l’IA, il faut au préalable avoir appris à les produire soi-même ».
Il convient, conclut le collectif, « de former les élèves à l’IA via un enseignement dédié et, pour les autres matières, de leur faire comprendre la nécessité de ne pas céder à la facilité qu’elle leur offre. Pour qu’ils en soient convaincus, nous devons réinventer une éducation qui valorise la joie de créer, le goût de l’effort et l’importance de l’erreur ».
Références :
Un renforcement des mesures d’encadrement des usages du numerique à l’école
Dans sa Circulaire de rentrée, 2025, Élisabeth Borne, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, résume les principales dispositions relatives à « l'usage raisonné du numérique à l’école ».
« L’usage du numérique à l’école doit s’inscrire dans une démarche progressive, adaptée à chaque étape de la scolarité, afin d’assurer un développement structuré et cohérent des compétences des élèves et leur permettre de construire leur citoyenneté. Les enjeux de santé et de bien-être des élèves doivent être pleinement pris en compte, en veillant notamment à limiter l’exposition excessive aux écrans et à s’assurer de la plus-value pédagogique du numérique. Cette approche sera présentée et expliquée régulièrement aux familles, plus particulièrement en début d’année scolaire.
L’expérimentation de la pause numérique au collège a démontré des effets positifs sur le climat scolaire, la sérénité des élèves et des personnels et la disponibilité des élèves aux apprentissages. La généralisation du dispositif Portable en pause dans les collèges doit permettre de garantir la mise à l’écart effective des téléphones portables et objets connectés des élèves. Les modalités d’organisation du dispositif seront déterminées au sein de chaque collège en lien avec les départements et les familles.
Au lycée, une réflexion mobilisant les élèves sur la place du téléphone portable au sein de l’établissement, et plus globalement du numérique, sera conduite notamment au sein des instances de démocratie scolaire. Cette réflexion a vocation à alimenter le projet d’établissement.
Parallèlement, l’actualisation des espaces numériques de travail et des logiciels de vie scolaire sera suspendue par défaut le soir de 20 h à 7 h et en fin de semaine du vendredi 20 h au lundi 7 h (exception faite des établissements ouverts le samedi matin – du samedi 14 h au lundi 7 h) ».
Ces dispositions sont détaillées dans une circulaire en juillet 2025.
Seuls 8,5 % des collèges ont mis en place, en cette rentrée, le dispositif « Portable en pause »
Deux semaines après la reprise des cours, à peine 8,5 % des collèges ont réellement mis en place le dispositif "Portable en pause" rapporte le journal Le Monde. Selon une enquête menée par le Syndicat national des personnels de direction de l’Éducation nationale (SNPDEN-UNSA). 67 % des chef.fes d’établissement ne comptent pas l’appliquer. 42,8 % des chef.fes d’établissement reconnaissent être favorables au principe, tout en jugeant sa mise en œuvre trop compliquée. Seuls 6,9 % estiment qu’il est possible de s’organiser avec les moyens existants. Pour de nombreux chef.fes d’établissement, l’interdiction de 2018 régule déjà efficacement l’usage du téléphone portable. Dans beaucoup de collèges, son utilisation est aujourd’hui proche de zéro. Ils estiment donc inutile de complexifier le dispositif par une collecte systématique des appareils.
Références :
Plateforme numérique unique, manuels papiers, manuels numériques : un débat qui rebondit et qui divise la communauté éducative
À partir de la rentrée 2025, tous les lycéen.nes et enseignant.es d’Île-de-France devront utiliser Pearltrees, une plateforme numérique unique pour accéder aux manuels scolaires. La région Île-de-France cesse de financer les manuels papiers et réduit son budget pour les manuels numériques traditionnels, au profit de contenus conçus spécifiquement pour Pearltrees et accessibles gratuitement.
Cette décision a suscité une controverse, avec la publication d’une tribune dans le Monde, cosignée par des éditeurs de manuels, des enseignant.es et des écrivain.es. « il ne s’agit pas d’un simple choix technique, mais d’un choix de société. Il engage la transmission des savoirs, le lien entre l’école et les familles, et la liberté des enseignants ». Les signataires pointent, dans cette tribune, trois erreurs. « L’erreur, d’abord, de croire qu’un empilement de ressources numériques pourrait remplacer un ouvrage structurant, conçu dans sa globalité par des professionnels. Le manuel permet la construction progressive des savoirs, la lisibilité du parcours, le lien entre les notions. (…) L’erreur, ensuite, de croire que tous les élèves disposent des conditions matérielles et familiales pour s’orienter seuls dans un univers déstructuré. (…) L’erreur, enfin, de croire que l’innovation passe par l’imposition d’un outil unique, conçu et administré par une collectivité ».
Sur le site du Café pédagogique, Jean-Michel Le Baut, Professeur de français à Brest, actif au sein du Living Lab Interactik à Rennes, appelle à « réorienter le débat ». « Et si, dans cette « nouvelle guerre scolaire », on œuvrait à un cessez-le-feu ? Cela suppose de dépasser certains positionnements biaisés : pour ou contre les manuels scolaires, pour ou contre le numérique. Cela suppose peut-être d’écouter ce que les un·es et les autres ont à nous dire pour éclairer et reconsidérer le débat ». Jean-Michel Le Baut commence par distinguer « Pearltrees.com », service de curation grand public, de « Pearltrees Éducation, le service pédagogique actuellement déployé auprès de près de 2000 établissements en France et notamment des lycées franciliens. « Dans les usages pédagogiques réels, il s’agit d’une plateforme parfaitement sécurisée, intégrée au GAR, où on construit des espaces de travail et de partage collaboratifs avec ses classes. L’ergonomie serait difficile à prendre en main ? Beaucoup d’utilisateurices, y compris élèves, soulignent au contraire sa simplicité et sa fluidité, pour peu qu’on l’utilise régulièrement. Cela suppose, comme toujours, le déploiement d’une formation, continue, aux manipulations et aux possibilités ».
Aux enseignant.es qui déplorent une « perte de contrôle ou de liberté pédagogiques », Jean-Michel Le Baut fait valoir que « l’ usage de Pearltrees Éducation, c’est moins d’accéder à des manuels numériques (quand ils sont disponibles) que de produire leurs propres « manuels », personnels ou personnalisés, évolutifs, adaptés, différenciés, collaboratifs, multimédias (…) La plateforme ouvre des possibilités que n’offrent pas les manuels habituels, qu’ils soient papier ou numérique, des possibilités qui sont apparues, témoignent les collègues, particulièrement précieuses lorsqu’il fallut assurer en temps de confinements la « continuité pédagogique (…). Il convient donc bel et bien de sortir des visions univoques, orientées, manichéennes : la réalité est bien plus complexe et intéressante que celle que décrivent certains conservatismes, économiques, politiques ou pédagogiques ».
Des questions demeurent, reconnait toutefois Jean-Michel Le Baut, en particulier de gouvernance. « Peut-on déployer massivement, une fois de plus, un outil pédagogique sans concertation avec le personnel enseignant ? Faut-il orchestrer ainsi une concurrence brutale entre manuels et plateformes, entre papier et numérique, au lieu de chercher à les articuler intelligemment, au lieu de favoriser la liberté de choix en fonction de la pédagogie que l’on veut mettre en œuvre ? ».
Références :
Des pistes pour améliorer la relation numérique entre l’école et les parents
Le numérique, avec le déploiement des espaces numériques de travail (ENT) dans les années 2000, et celui, concomitant, des logiciels de vie scolaire, a profondément transformé les relation école-famille : leur rythme et leurs modalités. Les parents peuvent désormais accéder directement aux contenus des cours, à l’agenda, aux notes, aux devoirs et absences des élèves. En 2020, la crise sanitaire a marqué un tournant important dans l’usage des ENT pour permettre la continuité pédagogique.
Cette numérisation de la relation école-familles, si elle renforce la capacité parentale à soutenir le travail à la maison n’est pas sans conséquences : la possibilité pour les parents de suivre quotidiennement le travail scolaire peut augmenter la pression scolaire, avec une surveillance plus rapprochée, qui n’est pas toujours vécue positivement par les élèves, en particulier ceux en difficulté ou en décrochage.
Les enseignant.es, de leur côté, peuvent avoir « le sentiment d’une ingérence dans leur travail à cause de l’accès des parents et de leur hiérarchie à certains de leurs contenus de cours » observait le Cnesco en 2020. « Ils ressentent également une forme d’ingérence dans leur vie personnelle à cause de la messagerie et ils craignent une trop forte sollicitation de la part des élèves et/ou des parents ».
Dans un rapport consacré à l'impact du numérique sur les relations entre l'école et les familles, l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) alerte sur l'usage intensif des ENT et logiciels de vie scolaire notamment en dehors du temps scolaire. Elle recommande la mise en œuvre d'un droit à la déconnexion (pas de nouvelles publications entre 20h et 7h, ni durant les week-ends et vacances).
Rappelant que les familles les plus éloignées du numérique rencontrent des difficultés d'accès ou de compréhension des ENT, l'inspection recommande de mobiliser, dans le cadre d’une « alliance éducative » les conseils départementaux, les associations, les conseillers numériques et France Services, les caisses d'allocations familiales, pour maintenir et développer, dans l’ensemble des territoires, cet accompagnement.
Les inspecteurs généraux formulent 16 mesures pour remettre de la cohérence dans le développement des ENT et des logiciels de vie scolaire, pour lever les freins à leur utilisation, pour accompagner les parents éloignés du numérique et pour corriger les utilisations parfois stressantes de ces outils.
Lire la suite : Comment le numérique transforme-t-il la relation école-famille ?
Articles en lien
[Dossier] Rentrée scolaire 2024 : le numérique éducatif tiraillé entre usage raisonné des écrans et appropriation de l'intelligence artificielle

[Dossier] Rentrée scolaire 2023 : quelle stratégie pour le numérique éducatif ?

[Dossier] Numérique éducatif rentrée 2022 : état des lieux des projets en cours et des nouvelles initiatives

Pix parents : un nouvel outil pour la parentalité numérique
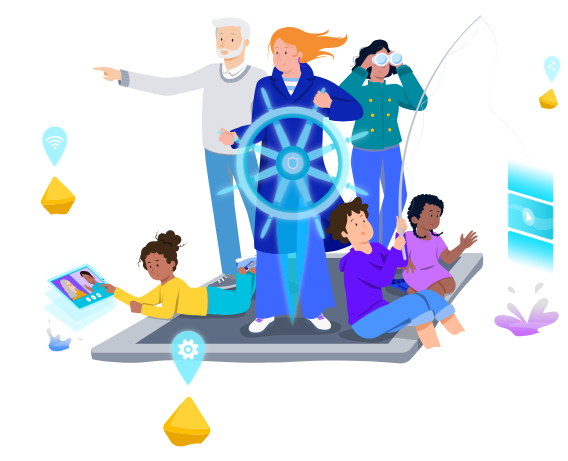
[Dossier] Comment le numérique transforme-t-il la relation école-famille ?






