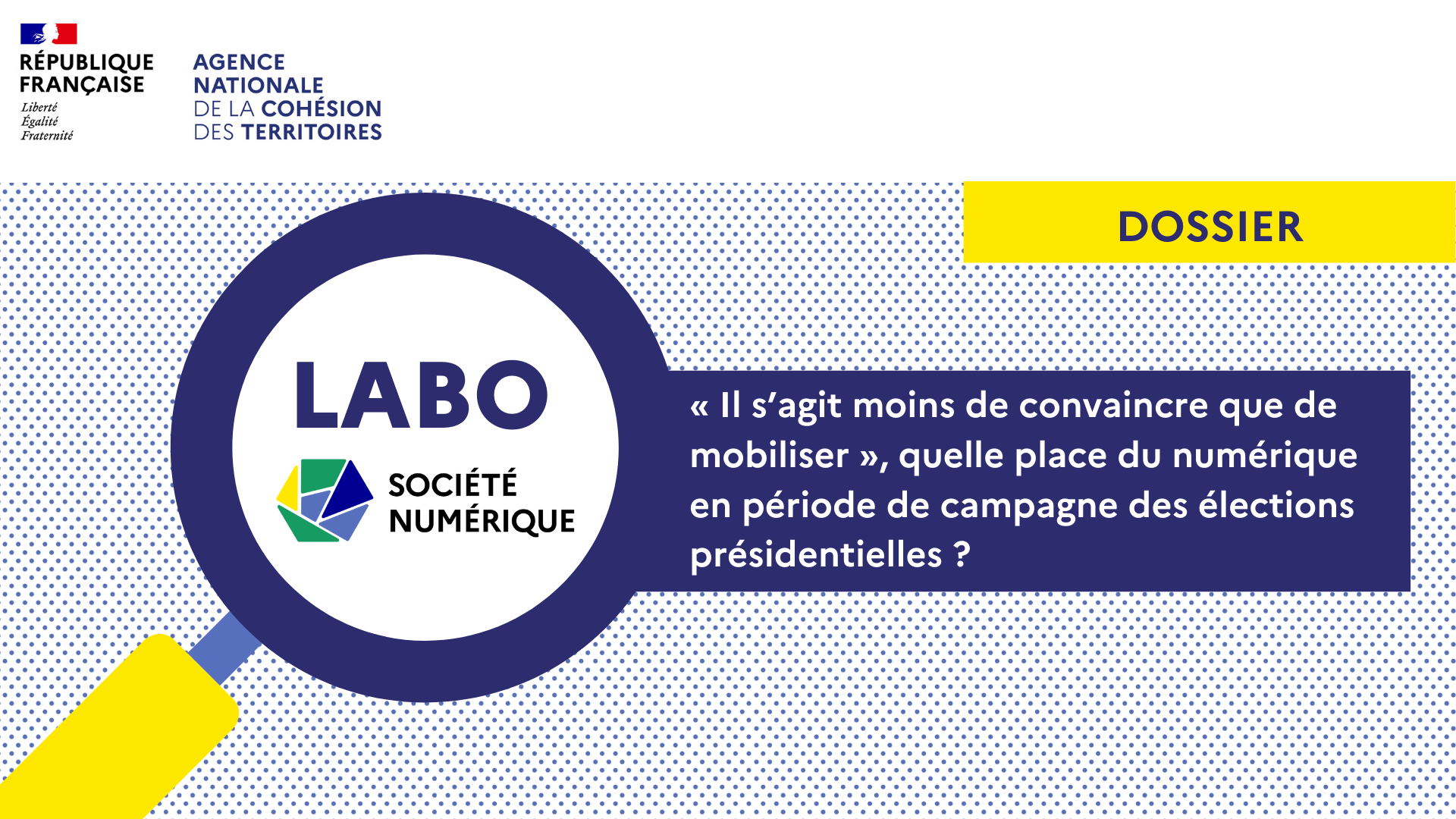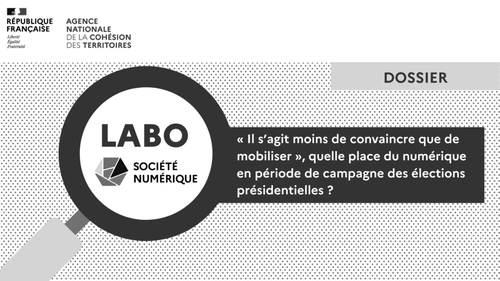
Référence :
Avant-propos
Les outils numériques ont, au fil des années, profondément transformé les campagnes électorales. Les réseaux sociaux modifient la manière dont les électeur.rice.s « suivent » la campagne (les sondages, les initiatives et les « coups » politiques des candidats, ses péripéties). Ils permettent aux plus concerné.e.s d’entre eux/elles, de prendre une part active à la campagne : en relayant les thématiques, les argumentaires, les vidéos de leur candidat.
Les équipes de campagne, pour leur part, mettent en œuvre de véritables stratégies numériques pour susciter, activer, coordonner l’engagement de ces militant.e.s numériques d’un nouveau genre, très majoritairement non encartés dans les partis politiques.
En ce sens, le numérique enrichit et renouvelle le « répertoire d’action électorale » : avec de nouvelles modalités d’engagement pour les citoyens, et de nouvelles manières de « faire campagne » pour les candidats et leurs équipes.
Malgré une profusion de baromètres qui scrutaient la présence numérique des candidats et la mobilisation de leurs partisan.e.s, la question de l’impact des réseaux sociaux, des nouvelles formes de « militantisme numérique » sur la formation des choix électoraux, et plus largement sur la « fabrique de l’opinion » reste assez largement ouverte.
Référence :
Sommaire
- Quels usages numériques en période électorale ?
- 2022 : Une profusion de baromètres pour scruter l'engagement et la mobilisation des électeur.trice.s sur les réseaux sociaux
- Les sciences sociales pointent une surestimation de la contribution des réseaux sociaux à la formation des opinions
- Les messageries instantanées, face invisible des campagnes numériques
- Nouvelles recherches, nouveaux questionnements autour des usages politiques du numérique
Références :
Quels usages numériques en période électorale ?
La principale source de connaissance des pratiques numériques des électeur.rice.s reste l’Enquête électorale française (ENEF), réalisée par Ipsos pour le compte du Cevipof, du Monde et de la Fondation Jean Jaurès.
Portant sur un panel de 10 000 personnes, interrogées onze fois entre avril 2021 et mai 2022, l'ENEF combine des questions relatives aux opinions et aux intentions de vote avec des questions relatives aux moyens de s’informer des électeurs ainsi que sur leurs modes d’engagement. Elle « permet d’étudier des pratiques minoritaires (par exemple liker un candidat) et d'analyser le profil de certains groupes, opérations qui n’auraient aucune significativité statistique avec un échantillon standard de 1000 individus même parfaitement représentatif ».
Le Cevipof n’a publié, à ce jour, que quelques données fragmentaires relatives aux pratiques informationnelles des électeur.rice.s lors de la présidentielle 2022.
, interrogés sur « les 15% déclaraient avoir ». Au second rang des moyens de s’informer, juste après les émissions politiques à la télévision, mais devant la presse écrite et les programmes des candidats reçus dans les boites aux lettres.
A partir de l’Enquête électorale française, Thierry Vedel avait distingué lors de la trois types de pratiques informationnelles en matière politique :
S’agissant des réseaux sociaux, Thierry Vedel observait que « concluait Thierry Vedel
Référence :
On y apprend qu’en seuls 7% des 11 000 répondants citaient les « comme « » et 19% comme l’un des « principaux moyens de le faire.
décembre 2021, réseaux sociaux, forums et blogs »premier moyen de s’informer sur l’actualité politique»
En avrildifférentes manières de s'informer sur les programmes des candidats, laquelle avez-vous privilégié ? »,« cherché des informations sur Internet
2017 : trois types de pratiques informationnelles en matière politiquecampagne 2017,
- Environ 15 % des électeurs ont des pratiques informationnelles intensives et plurimodales, c’est-à-dire qu’ils utilisent plusieurs sources d’information en cumulant supports traditionnels et supports en ligne : écoute régulière des informations télévisées, partage d’information sur les réseaux sociaux, visionnage des clips de campagne, lecture des professions de foi, etc. Lors de la campagne, ce groupe a intensifié ses activités politiques en ligne, mais modérément dans la mesure où elles étaient déjà élevées au départ.
- D’autres électeurs (environ 45 % de la population) ont des pratiques informationnelles plus fragmentées et plus sporadiques. Ils combinent en général deux supports (télévision et presse écrite pour les plus âgés, télévision et réseaux sociaux pour les jeunes gens). C’est dans ce groupe que les activités politiques en ligne se sont le plus intensifiées au cours de la campagne.
- Enfin, un troisième groupe (environ 40 % de la population) a des pratiques informationnelles en matière politique extrêmement réduites qui se résument souvent au visionnage de la télévision. Ce groupe, bien que fortement présent sur les réseaux sociaux, utilise assez peu l’internet pour suivre les élections.
2017 : Ce sont surtout les électeur.rice.s les plus politisé.e.s et les plus diplômé.e.s qui sont les plus actifssi environ les deux tiers des électeurs ont un profil ou un compte sur les réseaux sociaux, seule une minorité y a recours pour échanger ou exprimer des opinions politiques. Ce sont surtout les électeurs les plus politisés et les plus diplômés qui sont les plus actifs. Au-delà de la recherche d’information, l’internet n’est pas (encore) devenu un espace majeur du débat politique. Ce qui ne signifie pas qu’il soit sans importance dans la compétition électorale ». « S’’il y a une distinction à établir », , « elle ne réside pas dans les sources mais dans les pratiques informationnelles (…). Le facteur principal qui a commandé ces pratiques informationnelles au cours de la campagne présidentielle est l’intérêt pour la politique : plus celui-ci est élevé, plus les pratiques informationnelles sont diversifiées et fortes (...). Ce n’est pas tant l’internet qui conduit à la politique, mais bien l’intensité de la politisation qui suscite un recours à l’Internet ».
2022 : Une profusion de baromètres pour scruter l'engagement des électeurs sur les réseaux sociaux
Il semblait acquis pour de nombreux observateurs - et pour les médias - que les réseaux sociaux allaient constituer un enjeu essentiel, voire décisif, de la campagne présidentielle : à la fois un fois terrain de jeu pour les candidats et leurs soutiens, et terrain d'observation permettant de suivre, voire même d’anticiper, des évolutions de l’opinion et les dynamiques de campagne.
Plusieurs facteurs expliquent cette focalisation de l'attention sur les réseaux sociaux : Une profusion de baromètres et d'observatoires ont été mis en œuvre par des cabinets spécialisés afin de mesurer la visibilité des candidats sur les réseaux sociaux et de scruter la mobilisation de leurs relais et sympathisants : nombre de posts mentionnant chaque candidat, pourcentage d'abonnés gagné par les candidats, nombre moyen d'interactions par publication sur l’un ou l’autre des réseaux sociaux, publications Facebook ayant suscité le plus de réactions, vidéos liée à la présidentielle la plus likées sur YouTube ou sur TikTok, tweets les plus partagés, post Instagram les plus likés etc.
- En premier lieu, l’idée s’est installée, fin 2021, dans un contexte sanitaire encore incertain, qui limitait les grands rassemblements (aucun candidat ne souhaitant voir un de ses meetings se transformer en cluster) que l’issue de la campagne se jouerait, en partie, sur les réseaux sociaux.
- L’avènement de nouvelles plateformes (TikTok et Switch) fréquentées principalement par un public de jeunes adultes dont le taux d’abstention est souvent élevé. Si la campagne numérique s’était déployée, en 2017, essentiellement sur YouTube, Facebook et Twitter, la campagne 2022 voyait l’émergence de nouvelles arènes numériques, Instagram, TikTok et Switch, et, avec ces plateformes, le déploiement de nouveaux formats : les interviews participatives de Twitch, les formats courts de TikTok.
- L’irruption dans la campagne d’une nouvelle génération d’influenceurs, qui affichaient leur volonté de réconcilier la jeunesse avec la politique, comme HugoDécrypte, et ses 1,9 millions d’abonnés sur TikTok, 1,6 sur Instagram, 2 millions sur YouTube, 214 000 sur Twitch.
Autant de mesures et de métriques largement commentées par les médias :
- Twitch, Snapchat, TikTok : quand le numérique tente de reconnecter les jeunes à la politique ?
- Quel candidat a tiré son épingle du jeu sur les réseaux sociaux en janvier ?
- Quel candidat a fait le plus de bruit en décembre sur les réseaux sociaux ?
- Twitch peut-il faire reculer l'abstention des jeunes ?
Références :
Les sciences sociales pointent une surestimation de la contribution des réseaux sociaux à la formation des opinions
Autour de la place du numérique dans les campagnes électorales, a vu le jour un champ de recherche, au croisement de la science politique, de la sociologie, des data sciences et des sciences de l'information.
Les universitaires, invités par les médias à commenter, tout au long de la campagne, les évolutions du nombre d’abonnés aux comptes Facebook ou Twitter de tel ou tel candidat, ou la mobilisation différentielle de leurs soutiens, firent preuve d’une grande prudence.
« Les effets qu'on attribue aux réseaux sociaux en terme d'influence sur le résultat des élections sont surestimés »
Pour Fabienne Greffet, chercheuse en science politique de l’Université de Lorraine, en février, sur FranceBleu, « les effets qu'on attribue aux réseaux sociaux en terme d'influence sur le résultat des élections sont surestimés. On a de la difficulté à mettre en relation le nombre de personnes concernées avec ce qui se donne à voir sur les réseaux sociaux, il y a toute une part de mise en scène et donc il faut avoir en tête que l’on peut aussi être en butte à des dizaines de stratégies de recherche d'influence, sans pour autant que les groupes mobilisés représentent des centaines ou des milliers de personnes. Et justement, un des effets recherchés ça peut-être de faire croire qu'un candidat est très soutenu ou très attaqué sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, l'opération est menée par un petit groupe ».
« Quand on observe la cartographie des réseaux, on observe que les communautés numériques les plus actives sont idéologiquement très homogènes. Il y a finalement peu d'échanges entre les communautés. Il s'agit plus souvent d'échanger des contenus avec des personnes qui pensent comme nous puisque généralement, notre réseau relationnel est plutôt constitué de personnes qui pensent comme nous. »
Les citoyens actifs sur Internet plus radicaux
Cinq chercheur.euse.s, Marie Neihouser, Felix-Christopher von Nostitz, François Briatte, Giulia Sandri et Tristan Haute rappelaient, en avril 2022, dans TheConversation que les usages électoraux des réseaux sociaux, s'ils se développent depuis 2012, restent cependant relativement minoritaires.« Les commentaires à la suite de messages de candidats restent relativement peu nombreux tant sur Twitter que sur Facebook (…) si on les rapporte au nombre d’inscrits sur les listes électorales, ou même au nombre de personnes inscrites sur les réseaux sociaux en France (40 millions d’utilisateurs mensuels de Facebook, 8 sur Twitter, 22 sur Instagram, 50 sur YouTube). Surtout, certains candidats ne récoltent que quelques centaines de commentaires – ou même moins. Même si l’on regarde le nombre de likes, pratique moins coûteuse pour les internautes que le commentaire, les réactions aux messages des candidats restent relativement rares, a fortiori lorsqu’on les compare à leurs nombres d’abonnés ». « On sait que les citoyens politiquement actifs sur Internet présentent différentes caractéristiques : ils sont plus intéressés par la politique, plus diplômés, et plus jeunes que la moyenne ».
Les publications en ligne touchent avant tout les publics déjà acquis à la cause
« Depuis plusieurs semaines et parfois plusieurs mois, les candidats occupent le plus possible leur territoire de visibilité, c’est-à-dire l’intégralité des réseaux sociaux – ou presque – et les médias traditionnels. Mais il est très difficile de mesurer l’impact que peuvent avoir les différentes formes de communication numérique sur les comportements électoraux », observait, pour sa part, Stéphanie Wojcik (Université Paris-Créteil), interrogée par Usbek & Rica.« On dit souvent, et à juste titre, que les publications en ligne touchent avant tout les publics déjà « captifs », à savoir les militants et les sympathisants – bref, tous ceux déjà acquis à la cause. »« Pour les candidats, tout l’enjeu consiste à élargir le cercle habituel de leur audience. Bien sûr, il paraît évident que si vous vous acculturez correctement à un dispositif spécifique comme TikTok, sur lequel vous produisez des vidéos courtes avec un ton plutôt humoristique ou léger, vous allez capitaliser sur l’audience de ce réseau (…). Mais il peut aussi exister une contradiction entre ces impératifs et la communication politique électorale en tant que telle, qui ne se satisfait pas toujours de durées aussi courtes. Parfois, il peut carrément être contreproductif pour un responsable politique de tenter d’aller sur une plateforme où il n’est pas très à l’aise. »
Pour Jen Schradie, chercheuse à SciencePo (auteure de "L'illusion de la démocratie numérique. Internet est-il de droite ?"), « les réseaux sociaux fonctionnent comme des mégaphones ou des projecteurs, qui déforment ce qui se passe dans la réalité de plein de manières, et la campagne présidentielle française n’a pas échappé à cela ».
Les réseaux sociaux en campagne comme un meeting à ciel ouvert
Pour Olivier Ertzscheid, Maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication à l'Université de Nantes, auteur du blog Affordance, c'est l'image du meeting qui apparaît « la plus appropriée pour arbitrer sur le rôle et la place que jouent réellement les réseaux sociaux dans une élection ».
« Un meeting politique est un reflet d'une dynamique : la capacité d'y faire salle plus ou moins comble, la capacité d'y disséminer des éléments de langage et des clés d'analyse qui structureront ensuite et la campagne et l'opinion, la capacité de convaincre et de mobiliser bien sûr. Les réseaux sociaux sont tout cela à la fois ».Dans un meeting on ne croise que des convaincu.e.s. Plus de 90% des personnes qui se rendent à un meeting sont déjà concaincu.e.s et seuls quelques curieux ou opposants viennent achever d'en remplir les rangs. Or la manière dont on s'adresse à une salle composée de 90% de convaincu.e.s, et la manière dont cette salle agit et réagit, est sans aucune commune mesure avec la manière dont on peut s'adresse à une salle qui serait hostile ou en tout cas composée d'au moins autant de convaincu.e.s que d'opposant.e.s. C'est à peu près la même chose sur les réseaux sociaux généralistes ».
Dominique Cardon sur RadioFrance, rappelait aux rédactions qu’elles « doivent avoir une culture numérique de l’enquête. Être capables d’évaluer quelle est la prévalence d’une thématique dans l’opinion. Et surtout ne pas considérer que ce qui se dit sur Twitter est le reflet de l’opinion publique. Ce serait une grave erreur. Car seule une partie très infime des français se retrouve sur ce réseau social. Souvent ce sont des journalistes, des gens diplômés et urbains. Peu représentatifs donc du reste de la population. Les sujets les plus commentés sur Twitter ne sont pas forcément ceux qui intéressent les Français ».
Références :
Les messageries instantanées, face invisible des campagnes numériques
Marie Turcan, rédactrice en chef du site Numerama, attire l’attention sur « ce que l’on ne voit pas… Derrière ce qui est public, Facebook, Twitter, vous avez un autre paysage numérique. Aujourd’hui, beaucoup de Français s'informent par ces canaux alternatifs, que sont les boucles et les messageries WhatsApp ou Telegram (…). Ce sont des phénomènes peu visibles, mais qui peuvent compter et avoir de l’influence. Je pense qu'il ne faut pas minimiser l'impact de ces sous-groupes qui peuvent rassembler des centaines de milliers d’internautes ».
Un point de vue partagé, dans Mediapart, par Jen Schradie : « on manque sans doute un phénomène massif qui demeure une boîte noire, à savoir les boucles privées sur WhatsApp, Telegram, Signal ou les groupes privés sur Facebook, alors que c’est sans doute là qu’une partie de la politique numérique se joue ».
Olivier Ertzscheid, pour sa part, voit « dans l'ensemble de ces partages invisibles de contenus (…) qui ne peuvent donc être ni observés, ni mesurés, ni comptabilisés (ou en tout cas beaucoup plus difficilement) un espace désormais déterminant et structurant pour l'ensemble des mouvements et des mobilisations politiques ou citoyennes ».
Il pointe, à ce propos, « un paradoxe de visibilité qui peut s'exprimer de la manière suivante : les contenus ainsi "publiés" peuvent jouir d'une visibilité très forte dans les groupes privés où ils sont diffusés ou repris, mais leur visibilité "analytique" publique, celle qui permet d'observer et de tenir compte de leur viralité, est en revanche quasi-nulle ». Olivier Ertzscheid rappelle, au passage, que WhatsApp avait été abondamment utilisé par les partisans du candidat Jair Bolsonaro pour le faire élire lors de la campagne présidentielle de 2018.
L'hypothèse d'une tripartition de l'espace politique
Olivier Ertzscheid voit se dessiner une «tripartition pour l'ensemble des débats et élections à venir, en France comme ailleurs.
- En premier lieu et en premier tempo, reste et demeure la surface mass-médiatique de l'agenda politique et des influences partisanes (la télé et la presse continuent de jouer un rôle déterminant et crucial dans la fabrique de l'opinion).
- Vient en deuxième lieu et en deuxième tempo la surface sociale interpersonnelle partisane qui se donne à lire explicitement dans les réseaux sociaux généralistes et dans leurs logiques éditoriales propres (les Trending Topics de Twitter par exemple).
- Viennent enfin en troisième lieu les espaces sub-médiatiques d'influence, (le Dark Social ) principalement fait de messageries privées, et qui donnent aujourd'hui le troisième tempo de l'agenda électoral et politique ».
Références :
Nouvelles recherches, nouveaux questionnements autour des usages politiques du numérique
Fabienne Greffet et Marie Neihouser ont entrepris, dans un appel à articles concernant « la digitalisation des répertoires d’action électorale », de retracer les débats qui traversent la communauté de chercheur.euse.s qui s’intéressent aux usages politiques des outils numériques.« Au tournant des années 2000, la littérature spécialisée de langue anglaise s’est fortement clivée autour d’une question: l’investissement des espaces numériques peut-il conférer des ressources supplémentaires à des formations politiques ou des candidats auparavant trop minoritaires pour accéder à des positions électives, ainsi qu’aux médias de masse ? »
Les recherches se focalisent, dans les années 2010, sur la professionnalisation des campagnes numériques, avec le recours à des personnels spécialisés : conseillers en communication numérique, chargés de communication web, community managers, data scientists.
En parallèle, prend naissance une interrogation « sur le degré d’initiative des citoyens engagés sur les espaces numériques » avec, selon les auteures, une tension entre deux types d’analyses : celles qui défendent l’idée selon laquelle « faire une campagne numérique consiste à perfectionner des techniques marketing de ciblage préexistantes » et celles qui estiment, au contraire « que les campagnes en ligne sont pour partie transférées des organisations partisanes vers les citoyens engagés ».
En France, les recherches se focalisent sur les pratiques numériques des personnes les plus investies dans les partis. «De fait, ce que font les personnes qui s’engagent en ligne de façon éventuellement ponctuelle pour un candidat ou un parti est assez mal connu, surtout lorsqu’il s’agit de personnes plus distantes de l’organisation, dites « sympathisantes », dont les activités retiennent peu l’attention des chercheurs. En outre, la vive controverse lancée par l’essayiste Evgueny Morozov, sur le slacktivism ou « engagement mou », a contribué à dévaluer les activités numériques d’engagement par rapport à l’action de terrain, et à les considérer comme des leurres qui donnent bonne conscience en créant l’illusion d’agir alors qu’ils n’ont aucun impact réel sur la mobilisation ou les résultats d’une élection ».
En conclusion, Fabienne Greffet et Marie Neihouser proposent aux futurs contributeurs trois axes de recherche et de réflexion :
- Les ressources et les acteurs de la digitalisation des répertoires d’action électorale. « Si certaines recherches se focalisent sur la professionnalisation des campagnes en ligne et l’apparition conséquente de nouveaux acteurs (data scientists, etc.), les ressources mises à disposition de ces nouveaux personnels afin de digitaliser les répertoires d’action électorale restent encore peu étudiées. Utilisent-ils les mêmes logiciels, les mêmes systèmes d’information ? Promeuvent-ils des « standards » de digitalisation ? En outre, la question se pose de comprendre comment se répartissent les rôles à l’intérieur des équipes de campagne entre « professionnels » (y compris des entreprises extérieures) et « amateurs », mais aussi entre organisation et communautés numériques sympathisantes, ou encore entre acteurs situés dans l’espace de la compétition électorale et acteurs situés géographiquement à l’extérieur (notamment à l’étranger) ».
- La digitalisation des répertoires d’action électorale en pratique. « En quoi de nouveaux supports, tels que les réseaux sociaux, sont-ils investis et avec quels objectifs ? Dans quelle mesure les répertoires d’action électorale sont-ils la continuation par d’autres moyens de répertoires d’action plus traditionnels ? Dans quelle mesure observe-t-on des ruptures, en s’appuyant par exemple sur des techniques de « propagande computationnelle » ou sur des actions numériques collectives telles que l’astroturfing, c’est-à-dire la création artificielle de ce qui apparaît comme un mouvement de masse et spontané en ligne ?
- Comment ces techniques et savoir-faire s’intègrent-ils à des répertoires de campagne plus large, notamment hors ligne ? »
- Les conséquences de la digitalisation des répertoires d’action électorale. « Dans ce troisième axe, ce sont les conséquences de la digitalisation des répertoires d’action électorale qui seront recherchées – tant du point de vue de l’organisation et des rapports de force au sein des partis et des équipes de campagne, qu’en termes d’activités et de contenus produits, ou encore d’évolution de l’intérêt et de la mobilisation des citoyens lors des campagnes électorales ».
Références :
Sources
3. La mise en avant, parfois artificielle, de sujets politiques sur Twitter
4. TheConversation: les citoyens actifs sur Internet sont-ils politiquement plus radicaux ?
8. Baromètre de la popularité digitale des candidats à l’élection présidentielle
9. Presidentielle 2022 : Barometre des sujets les plus commentés
10. Baromètre Présidentielles 2022 : Le Top des "candidats" sur les réseaux sociaux
11. Observatoire des Personnalités Politiques sur les réseaux sociaux
13. La mise en avant, parfois artificielle, de sujets politiques sur Twitter
14. TheConversation: les citoyens actifs sur Internet sont-ils politiquement plus radicaux ?
16. Affordance : Retour sur la campagne numérique de 2022 (avril 2022)
18. apart: On a sous-estimé le rôle des boucles numériques privées dans la campagne présidentielle
20. France Culture : Le bilan numérique de la campagne présidentielle 2022 (22 avril)
21. Affordance : Retour sur la campagne numérique de 2022 (avril 2022)